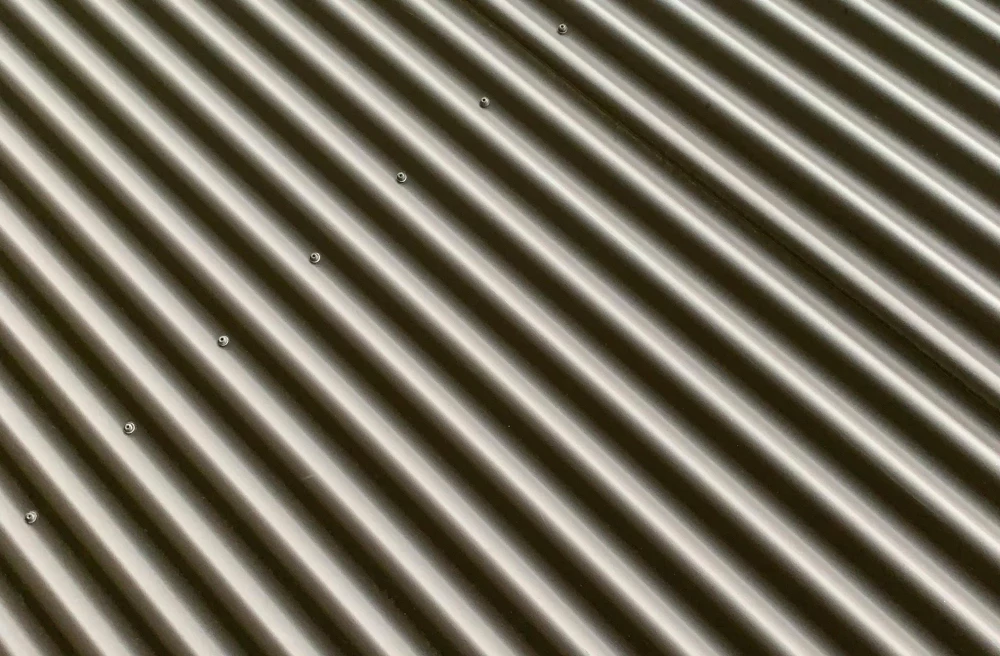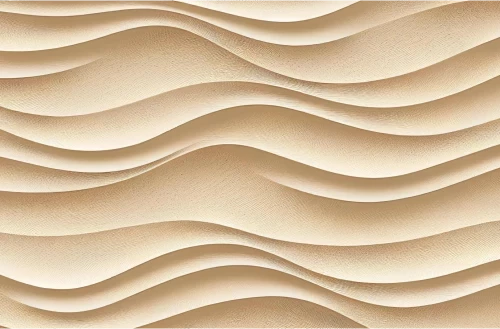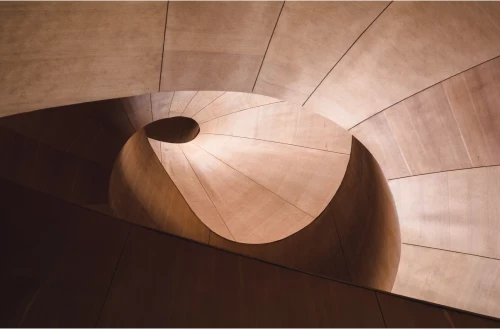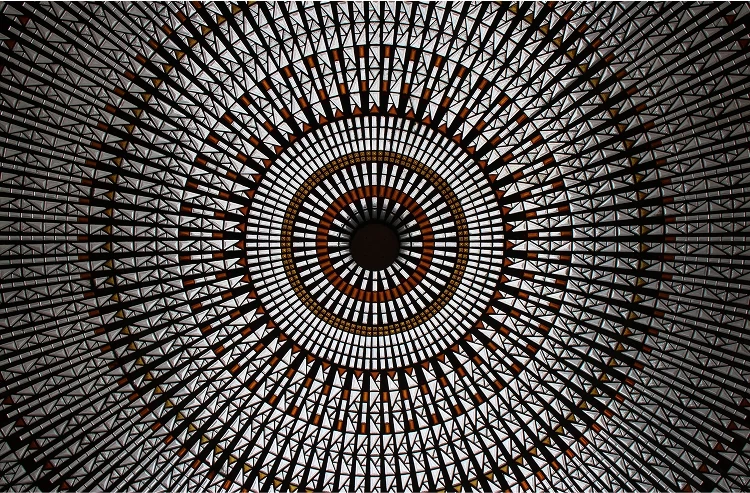Succession : les droits du conjoint survivant Comment mieux protéger son conjoint ?

Depuis 2001, le conjoint survivant non divorcé est traité comme un véritable héritier. Attention néanmoins, les enfants du défunt ou des membres de sa belle-famille dans le cas de familles recomposées limiteront ses droits.
Quel est le statut du conjoint survivant dans une succession ?
Le conjoint survivant non divorcé est considéré comme un héritier de son époux décédé. À ce titre, ce dernier bénéficie d’une protection prévue par la loi. Néanmoins, dans certains cas, le conjoint survivant peut se retrouver dans une situation difficile, notamment pour les familles recomposées. Pour éviter des situations extrêmes, il est conseillé de réaliser une donation entre époux ou un testament.
Il est ainsi possible de concevoir une solution sur mesure pour augmenter ou adapter ses droits.
Quels sont les droits du conjoint survivant ?
Quels sont les droits du conjoint survivant ?
Les droits du conjoint survivant vont dépendre de la situation familiale au moment du décès. Attention, les règles qui sont évoquées ci-dessous ne sont valables qu’en l’absence de testament fait par la personne décédée. Si un testament a été établi, il convient alors de consulter un notaire pour connaître la part revenant au conjoint survivant.
Le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant
Si le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, il peut alors choisir entre :
- l'usufruit de la totalité des biens du défunt (c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus),
- et la propriété du quart.
L'usufruit appartenant au conjoint peut être converti en rente viagère, s'il le souhaite ou si un héritier le demande. Enfin, l'usufruit peut également être converti en un capital, mais toujours d'un commun accord entre conjoint survivant et héritiers.


Le défunt laisse des enfants d’une précédente union
Dans le cas d’enfants d’une précédente union, le conjoint survivant n'a pas le choix et obtient la propriété du quart des biens du défunt.
Le défunt ne laisse pas d'enfant et a toujours ses parents
Le conjoint survivant obtient la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l'autre moitié. Si le défunt n’a qu’un seul parent, le conjoint survivant reçoit dans ce cas les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le reste.
Le défunt n'a ni enfant, ni petit-enfant, ni parents
Le conjoint survivant hérite de tout. Seuls les biens que le défunt a reçu par donation ou succession de ses ascendants (parents ou grands-parents) peuvent faire l’objet d’un traitement particulier. S’il existe encore des personnes vivantes dans cette succession, la moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants, l’autre moitié revenant au conjoint survivant.
Pour protéger son conjoint, il est possible de mettre en place différents mécanismes.
La donation au dernier vivant
Réservée aux époux, la donation au dernier vivant permet au conjoint survivant d’avoir des choix élargis en matière d’héritage. En tant que conjoint survivant, il ainsi possible de choisir de recevoir :
- la totalité de la succession en usufruit ou,
- le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou la quotité disponible (soit la moitié de l’actif successoral en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, et un quart en présence de trois enfants et plus).
Les avantages matrimoniaux
Grâce aux avantages matrimoniaux, il est possible d’augmenter la part des biens du couple dont le conjoint survivant deviendra seul propriétaire. Pour cela, un régime communautaire ou une société d’acquêts au sein d’un régime séparatiste doit être mis en place. En effet, les avantages matrimoniaux ne portent que sur des biens communs. Cette solution est recommandée pour les familles recomposées car elle permet d’éviter les démembrements et les indivisions entre les beaux enfants et le beau-parent.
Attention néanmoins, cette option s’apparente à un changement de régime matrimonial. Pour que celui-ci soit valable, il faut donc respecter un certain protocole et passer devant un notaire. Les enfants majeurs et les créanciers doivent ensuite être informés. À partir de là, ces derniers ont un délai de trois mois pour contester ou non ces avantages matrimoniaux. En cas désaccord, il faudra mettre en place une procédure d’homologation qui nécessite d’avoir recours à un avocat.

L’assurance-vie
Grâce à l’assurance-vie, il est possible de transmettre à son conjoint survivant une part plus importante que celle offerte par la loi. En effet, les capitaux perçus par les bénéficiaires ne sont pas comptabilisés dans la succession. Attention néanmoins, en cas de versement de primes « manifestement exagérées » , les descendants ont la possibilité d’intenter une action.

La transmission d’un patrimoine se prépare sur la durée et à tout âge. Depuis plus de 30 ans, nos équipes vous accompagnent dans l’anticipation et l’optimisation de votre succession.