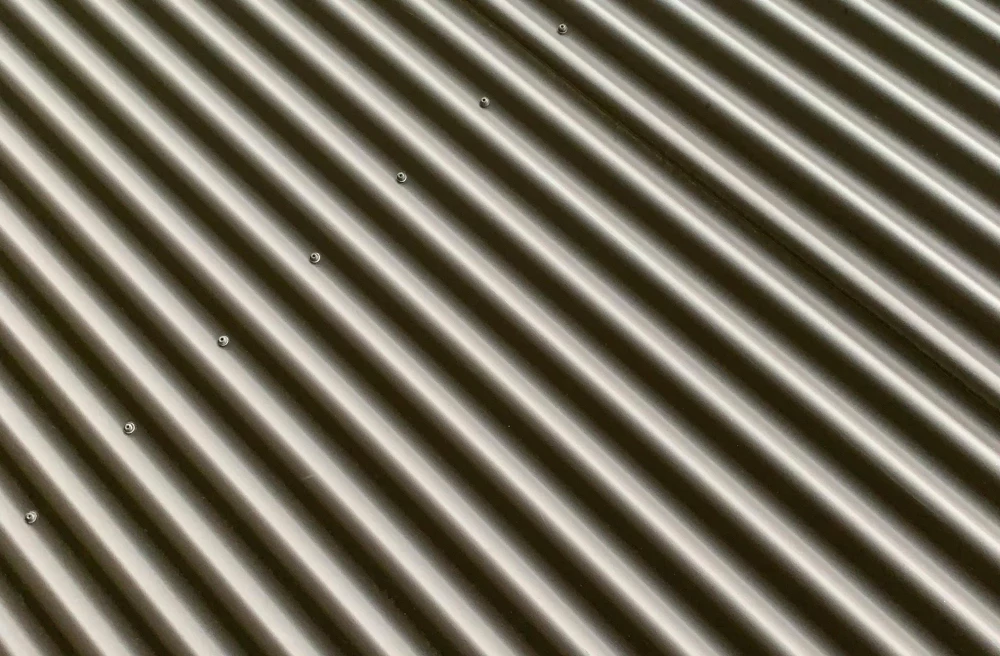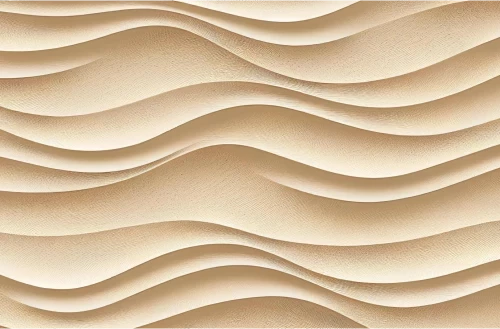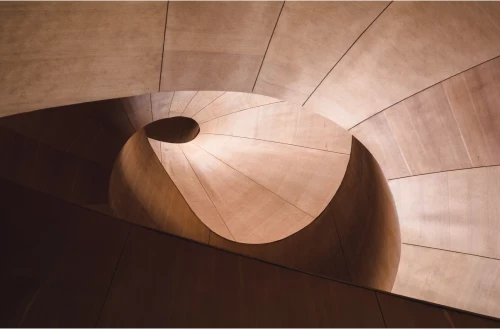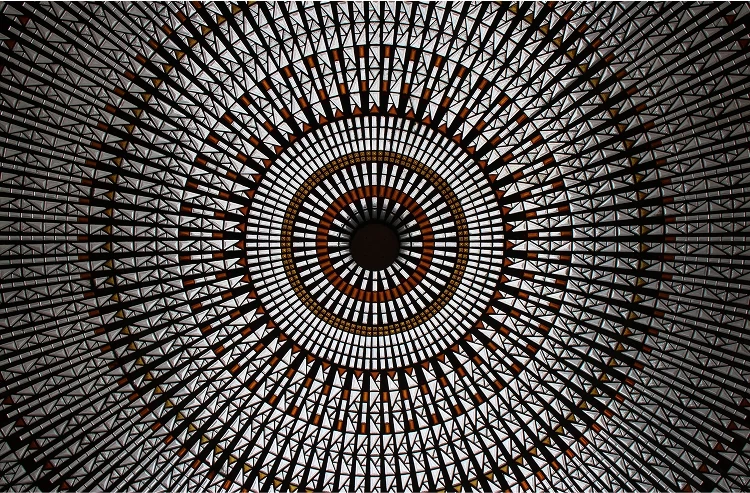Comment rédiger la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ? Rédaction et règles d’application d’une clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui recevront, au décès du souscripteur, un capital ou une rente dans des conditions fiscales avantageuses.
Attention, les règles d’application à suivre dans le cadre de la rédaction d’une clause bénéficiaire sont nombreuses.
Qu’est-ce qu’une clause bénéficiaire ?
Qu’est-ce qu’une clause bénéficiaire ?
Un contrat d’assurance-vie est plus qu’un simple produit d’épargne. Bien utilisé, il peut se transformer en une enveloppe fiscale qui permet, au décès du souscripteur, de transmettre des capitaux dans un cadre fiscal favorable. La clause bénéficiaire est essentielle, car elle recueille le nom des personnes choisies par le souscripteur pour recevoir le capital à son décès. Lors de sa rédaction, il est possible de désigner un membre de sa famille (père, mère, conjoint, enfants, etc.), une association ou toute autre personne.
À savoir : si aucun bénéficiaire n’est désigné, le contrat d’assurance-vie sera réintégré dans l’actif successoral. Cela a deux conséquences. Premièrement, ce sont les héritiers légaux qui bénéficieront du contrat et non ceux que le défunt aurait pu vouloir privilégier. Deuxièmement, le cadre fiscal particulier et avantageux de l’assurance-vie est perdu.
Par la suite, la clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment. Le changement doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur ou par testament notarié pour éviter les contestations.
Attention, l’acceptation n’est plus unilatérale. Il faut que souscripteur assuré et bénéficiaire aient contractualisé l’acceptation.


Les étapes clés de la rédaction de la clause bénéficiaire
Une clause standard est généralement utilisée : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. » Mais, elle n’est pas adaptée à toutes les situations. Pour le savoir, il faut se poser les questions suivantes :
- Le conjoint aura-t-il besoin de l’intégralité du capital ?
- D’autres bénéficiaires doivent-ils toucher une partie du contrat ?
- Si oui, dans quelles proportions ?
En fonction des réponses, il conviendra ainsi d’adapter la clause bénéficiaire afin de coller au plus près de ses besoins. Voici quelques astuces pour ne rien laisser au hasard.
1/ Prévoir des bénéficiaires en cascade en utilisant la mention « à défaut… »
En cas de prédécès du bénéficiaire de premier rang ou en cas de non-acceptation du bénéfice du contrat, il est recommandé de toujours prévoir une autre solution. Ainsi, il est préférable de terminer la rédaction de la clause bénéficiaire par « à défaut mes héritiers » .
2/ Désigner le conjoint par sa qualité et non par son nom
Avec les aléas de la vie, il est possible que le conjoint au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire ne soit plus le même au jour du décès. Cet argument est également valable pour les enfants. Ainsi, même si la composition de la famille évolue, les personnes ayant cette qualité seront les bénéficiaires. C’est pourquoi, si les enfants doivent figurer parmi les bénéficiaires, il faut indiquer « nés ou à naître » .
3/ Prendre en compte la notion de représentation
Une clause rédigée ainsi : « mes enfants, nés ou à naître, par parts égales » peut ne pas convenir. En cas de prédécès de l’un des enfants qui laisserait derrière lui des enfants, ces derniers ne le représenteront pas comme dans une succession classique. Ce sont alors le ou les bénéficiaires restants qui se partageront le capital. Si ce n’est pas ce qui est souhaité, il faut apporter cette précision : « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, par parts égales, à défaut… » . Ainsi, en cas de prédécès, la part qui lui était dévolue reviendra automatiquement à ses propres héritiers.

La rédaction d’une clause bénéficiaire ne s’improvise pas et doit se conformer à certaines règles. L’accompagnement dans cette démarche par un conseiller en gestion de patrimoine s’avère opportun.
avec un conseiller