Quels sont les principes juridiques de l’assurance-vie ?
Véhicule d’investissement privilégié de nos compatriotes pour sa souplesse de fonctionnement et de transmission patrimoniale, l’assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui codifié à l’article 1205 du Code Civil.
Assurance-vie : la stipulation par autrui
Ce mécanisme original permet à une personne (le stipulant) de demander à une autre (le promettant) de s'engager à fournir une prestation à un tiers bénéficiaire. Dans le cadre de l’assurance-vie, le stipulant est le souscripteur par ailleurs, le plus souvent, mais pas nécessairement, tête assurée du contrat. Il s’acquitte des primes auprès de la compagnie d'assurances émettrice du contrat (le promettant), qui s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.
Par une fiction juridique, le bénéficiaire, qui n’est pas partie à la convention qui lie l’assureur et le souscripteur, détient un droit direct sur les capitaux décès stipulés dans le contrat, ce dès sa conclusion.
Assurance-vie : dérogation du principe du « rapport à succession » et de la « réduction »
Lors du dénouement du contrat d’assurance-vie à raison du décès de la tête assurée, l’épargne transmise au(x) bénéficiaire(s) est réputée ne faire partie ni de la succession du souscripteur ni de celle de l’assuré selon l’article L132-12 du Code des assurances. Étant réputés ne pas être intégrés dans la succession du défunt souscripteur, les capitaux versés à un bénéficiaire « ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant » ainsi que le précise l’article L132-13 du Code des assurances.
Afin de protéger leur réserve héréditaire, les droits des héritiers enfants du défunt sont définis et calculés en fonction de l’état des biens existants au jour du décès, mais également en considération des donations consenties du vivant du défunt. C’est le principe dit du « rapport à succession ».
S'il devait donc apparaître à l’ouverture de la succession du donateur que l’un ou l’autre des cohéritiers aurait bénéficié de libéralité excédant la quotité effectivement disponible au jour du décès, il serait tenu d’indemniser ses cohéritiers soit en nature, soit en valeur. Tel est le principe dit de la « réduction ».
C’est à ces deux principes du droit commun successoral que l’assurance-vie déroge.
Cependant, et afin de garantir une protection juridique du droit des héritiers réservataires, le législateur a instauré des garde-fous en précisant, dans le second alinéa de l’article L132-13 du Code des assurances que les règles du rapport et de la réduction jouent lorsque les primes ont été « manifestement exagérées » eu égard aux facultés du souscripteur.
Une abondante jurisprudence a pu cerner l’excès manifeste des primes dont le montant peut être jugé excessif en considération des capacités financières du souscripteur, ses revenus, son patrimoine, son âge et sa situation familiale et l’usage qu’il entend faire du contrat souscrit.
Parlons Patrimoine Décembre 2024
Découvrez les autres articles :
- 152 500 euros
- Cas pratique : Transmettre son patrimoine via l’assurance-vie
- « On ne sera jamais plus jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge » (Coco Chanel)
- Les vertus de l’investissement programmé
- Le bel effet boule de neige de l'anatocisme
- Quel est le traitement fiscal successoral de l’assurance-vie ?

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
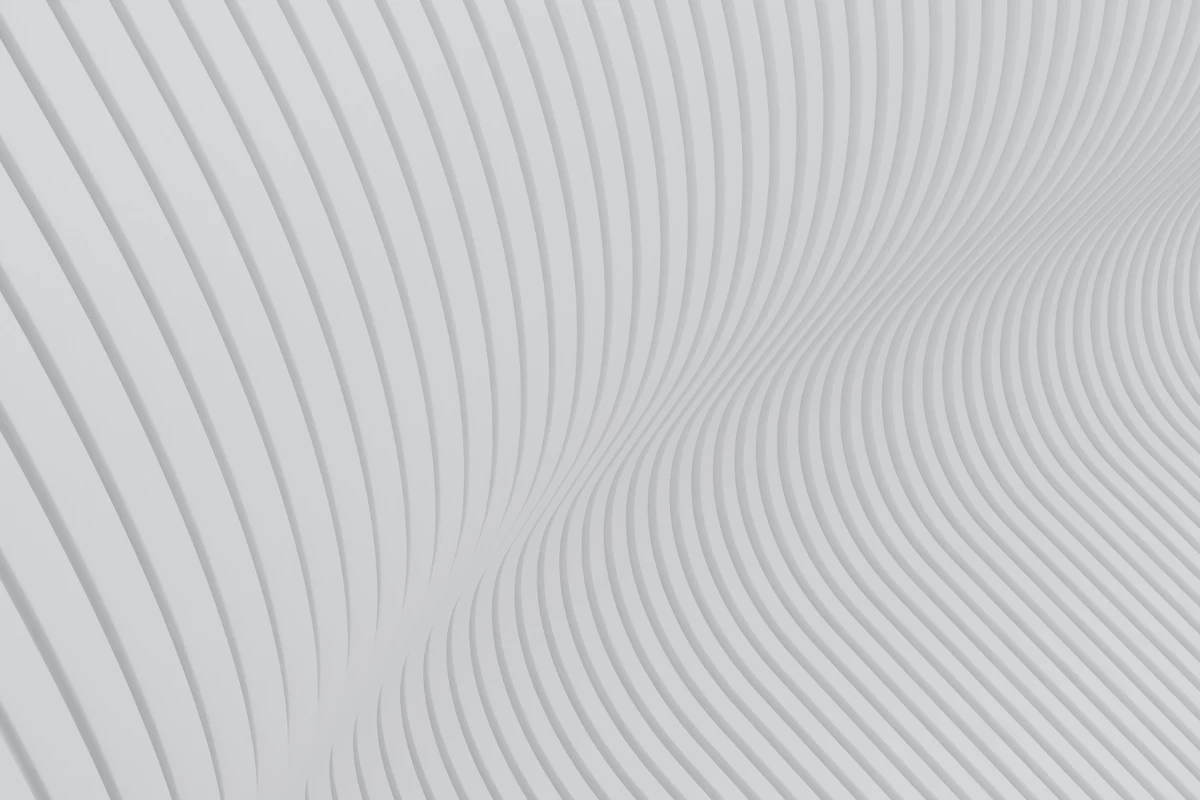
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
