L'Europe face à un tournant historique
Mars 2025 marque peut-être l'un des moments les plus décisifs de l'histoire européenne récente. Le 5 mars, les marchés financiers ont connu des mouvements spectaculaires : les rendements allemands à long terme ont bondi de 0,3 %, la plus forte hausse en une journée depuis trois décennies, tandis que l'euro s'est sensiblement apprécié. Ces secousses ne sont pas de simples soubresauts temporaires, mais traduisent une transformation plus profonde : l'Europe se trouve à l'aube d'un nouveau paradigme économique et géopolitique.
Au cœur de cette métamorphose se trouve l'Allemagne. Longtemps bastion de l'orthodoxie budgétaire avec son fameux « frein à l'endettement » , Berlin opère un virage à 180 degrés. Le futur chancelier Friedrich Merz a proposé un plan ambitieux incluant un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur dix ans, représentant 11,6 % du PIB allemand, ainsi qu'une réforme constitutionnelle excluant les dépenses de défense du calcul de la dette publique. Cette « révolution allemande » survient en réponse à un contexte international en mutation profonde, marqué par les tensions avec la Russie et l'incertitude quant à l'engagement américain envers la sécurité européenne.
Un nouveau modèle économique pour l’Europe
En parallèle, la Commission européenne a introduit une dérogation au pacte de stabilité permettant aux États membres d'augmenter leurs dépenses militaires jusqu'à 1,5 % du PIB sans déclencher de procédure pour déficit excessif. Cette initiative baptisée "ReArm Europe" inclut également un instrument de financement de 150 milliards d'euros garanti par le budget européen. Ces mesures combinées pourraient porter les dépenses militaires de l'Union européenne de 2 % à près de 4 % du PIB à horizon cinq ans, générant potentiellement jusqu'à 650 milliards d'euros d'investissements additionnels.
Cette mutation ne concerne pas uniquement la défense, mais annonce un changement de modèle économique pour le continent. Historiquement, l'Europe - et particulièrement l'Allemagne - a bâti sa prospérité sur les exportations, accumulant d'importants excédents commerciaux. Le nouveau paradigme vise à stimuler la demande intérieure en réduisant la dépendance aux marchés extérieurs.
Plusieurs facteurs structurels soutiennent cette transition :
- Le vieillissement démographique transforme l'Europe en une société âgée. Alors que l'âge médian de l'Union Européenne atteint désormais 45 ans, les comportements économiques évoluent : une population qui vieillit tend à « désépargner ».
- La double transition écologique et numérique nécessite des investissements massifs - estimés à 500 milliards d'euros annuels d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone.
- L'impératif de souveraineté technologique et industrielle incite l'Europe à développer ses capacités dans des secteurs stratégiques.
Un tournant décisif et des défis à surmonter
Ce tournant n'est pas sans défis. L'expansion budgétaire reste contrainte par les niveaux d'endettement élevés de certains pays, notamment l'Italie et la France. Par ailleurs, le vieillissement démographique pèsera sur la croissance potentielle, avec des pertes estimées entre 0,4 point (France) et 1,1 point (Italie) de croissance annuelle jusqu'à la fin des années 2030. De surcroît, l'effort militaire européen ne portera ses fruits que si le continent parvient à rationaliser ses acquisitions et à créer une véritable base industrielle de défense, évitant ainsi que ces dépenses ne bénéficient principalement aux fournisseurs américains.
L'histoire européenne a souvent montré que les crises servent de catalyseur à l'intégration. La convergence actuelle de l'Allemagne, de la France et même du Royaume-Uni post-Brexit autour de la défense européenne pourrait constituer une avancée significative. Pour que cette opportunité ne soit pas gaspillée, l'Europe devra cependant compléter son effort budgétaire par des réformes structurelles, notamment en décloisonnant ses marchés de capitaux pour orienter l'épargne excédentaire vers des investissements productifs plutôt que vers le financement du déficit américain.
Dans ce contexte de bouleversement, l'Europe se trouve à la croisée des chemins : soit elle parvient à transformer cette crise en opportunité, soit elle risque de subir une fragmentation accrue. Le déplacement du centre de gravité économique vers l'Allemagne, accompagné d'un modèle de croissance davantage tiré par la demande intérieure, constitue peut-être la meilleure chance pour le continent de préserver sa prospérité et son influence dans un monde de plus en plus instable et compétitif.
Parlons Patrimoine Mars 2025
Découvrez les autres articles :
- Professions libérales, quelles solutions de prévoyance mettre en place ?
- Marchés financiers : entre reconfigurations géopolitiques et inflexions monétaires
- Cas pratique : Comment développer des stratégies d'investissement adaptées à son profil ?
- Comment structurer son patrimoine pour mieux investir ?
- « If I go the turkish bath, I risque, I risque énormément. But if I reste ici, I risque encore plus... So, I risque on the two tableaux ! » Louis de Funès dans La grande Vadrouille
- Marchés secondaires en Private Equity : vers plus de flexibilité et d’innovation
- Gestion de trésorerie, une approche par les risques
- Le chiffre du mois : 6 333 milliards d’euros
- Où et comment investir utilement ?
- Cybersécurité et finances en ligne : adoptez les bons réflexes pour éviter les fraudes

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
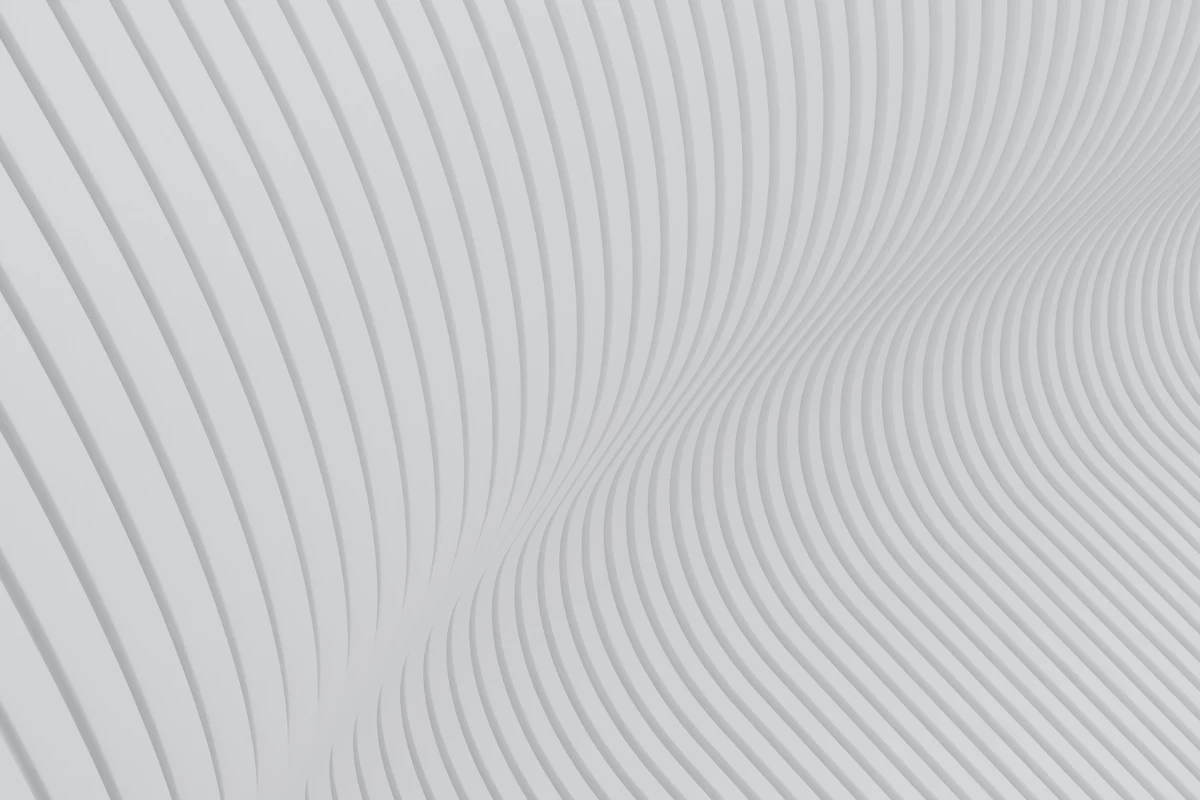
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
