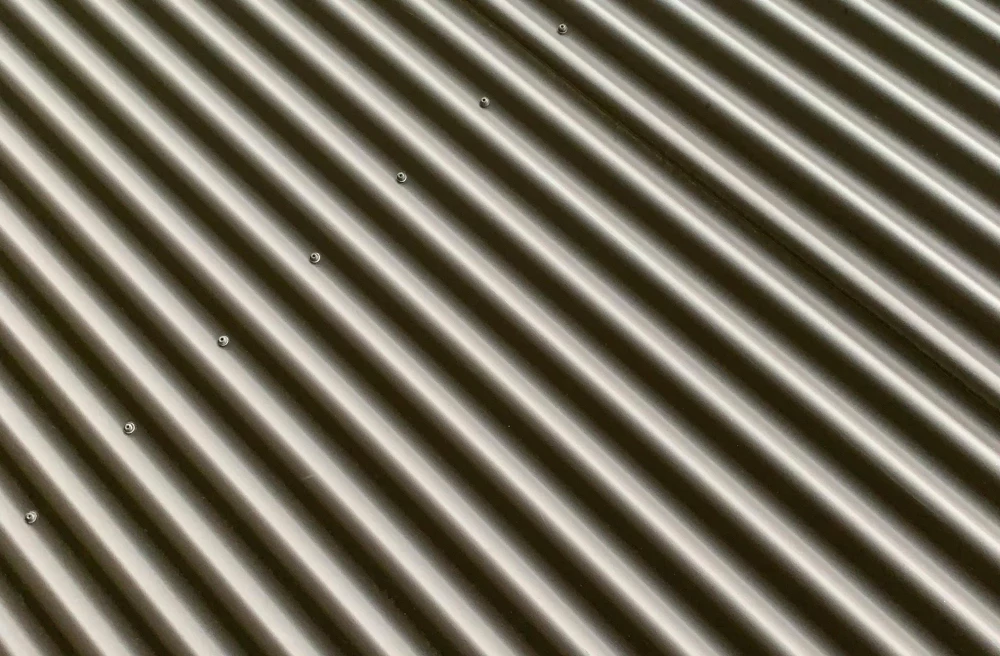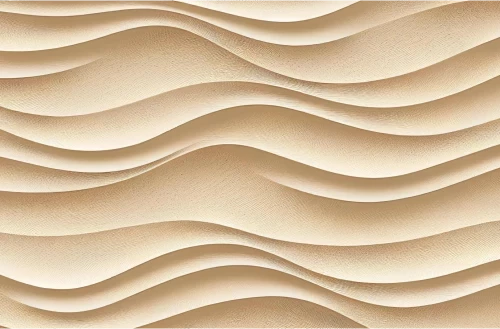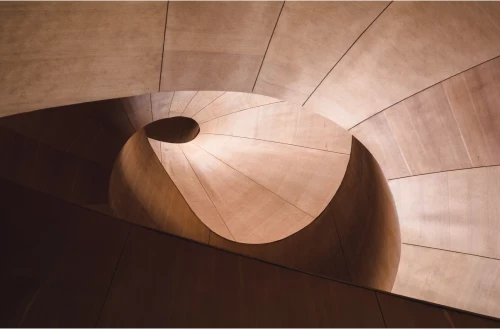Cession d’entreprise : garantie d’actif-passif et caution bancaire Comprendre les enjeux financiers d’une cession d’entreprise
Lors d’une cession d’entreprise, l’acquéreur demande généralement une garantie d’actif-passif, la GAP, pour se protéger contre des passifs non connus ou une surévaluation d’actifs. Il demande également une « garantie de la garantie » qui lui assurera d’être réglé en cas d’activation de la garantie de passif.
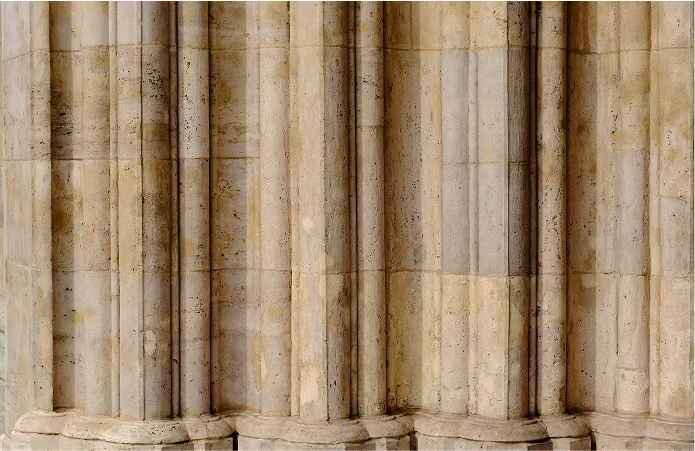
Les principes de la clause de garantie d’actif et de passif (GAP)

Les principes de la clause de garantie d’actif et de passif (GAP)
La garantie d’actif-passif est précisément déterminée dans le contrat de cession, avec une durée maximale d’application (en général 3 ans), avec une dégressivité potentielle et encadrée par des clauses faisant l’objet de discussions entre conseils en amont du closing de l’opération.
L’enjeu de ces négociations est d’un côté de sécuriser l’acquéreur, et de l’autre d’éviter au cédant de mobiliser une garantie trop importante et d’une durée trop longue.
La mise en place de la « garantie de la garantie »
Pour sécuriser l’activation de la garantie d’actif-passif (GAP), les conseils imposent généralement la mise en place d’une « garantie de la garantie » . Dans la plupart des cas, elle prend la forme d’un séquestre ou d’une caution bancaire.
Dans cette stratégie, la banque va demander que la provision mise en collatéral de la garantie fasse l’objet d’un nantissement. Le cédant va donc devoir mobiliser une partie de la trésorerie issue de la cession jusqu’à l’extinction de la GAP sur un contrat nanti à cet effet.
S’il est acquis qu’il ne pourra profiter de ces capitaux durant cette période, ou alors sous forme de déblocages successifs à date anniversaire (ex : 1/3 la 1ʳᵉ année, 1/3 la 2ème, etc…), il est important que cette période de blocage n’obère pas totalement leur rémunération.Ajoutons que le montant exigé est supérieur au montant garanti. Le surplus imposé dépend des instruments financiers sur lesquels le vendeur souhaite investir.
Pour un investissement en fonds monétaires, la banque applique habituellement une décote de l’ordre de 5 %. La baisse des rendements monétaires peut inciter le cédant à rechercher des stratégies plus rémunératrices. Dès lors que les investissements envisagés présentent un risque de marché, la banque appliquera une décote plus importante selon ses propres règles internes en fonction des risques perçus par celle-ci. La décote peut être supérieure à 30 % (obligations haut rendement, structurés, actions). Les instruments illiquides ne sont donc pas adaptés.
À noter : Sur une durée moyenne de 2 ans, il peut être préférable d’opter pour une caution bancaire/nantissement afin de bénéficier des produits financiers susceptibles d’être générés par le placement des sommes mises en provision.
Définir une stratégie financière adaptée

Définir une stratégie financière adaptée
La stratégie d’investissement adéquate dépendra ainsi de plusieurs paramètres :
- le montant du surplus disponible,
- l’horizon d’investissement,
- la tolérance au risque du cédant.
Le cédant doit aussi intégrer dans ses choix d’allocation une marge de sécurité supplémentaire par rapport à la décote exigée par la banque. En effet, l’investisseur doit se prémunir raisonnablement contre un scénario adverse qui lui imposerait de devoir céder des actifs risqués dans un creux de marché ou de devoir abonder pour respecter la contrainte de nantissement.

Il est primordial pour le cédant de bien préparer en amont de la cession les questions de garantie de la garantie d’actif-passif (GAP). La sollicitation d’un conseiller en gestion de patrimoine s’avère nécessaire, afin de procéder à un appel d’offres et de définir la stratégie adaptée aux objectifs et aux contraintes du cédant.
avec un conseiller
Julien Richard Directeur Régional Gestion Privée
François Jubin Senior Advisor