Les singularités françaises dans la gestion de l'épargne
Nos compatriotes retrouvent, jusque dans la gestion de leur épargne, des singularités spécifiques absentes de nos pays limitrophes européens.
Ces spécificités françaises sont liées à notre système juridique qui trouve son origine dans le droit romain, à notre culture fiscale redistributive, aux cadres réglementaires contraignants, ainsi qu'aux résultats d'une éducation financière à promouvoir.
Il en va ainsi du fameux fonds en euro, des produits d'investissement assurantiels dont la gestion est opérée par l'assureur, non seulement émetteur du contrat, mais aussi gestionnaire des montants souscrits selon les principes d'un modèle original s'affranchissant du "Mark to Market", soit de l'évaluation des composantes du portefeuille sur la base de leur valeur de marché.
Les fonds euro au plan financier
Au plan financier, la valorisation de l'actif général des compagnies ne subit donc pas les impacts négatifs d'une correction des marchés lorsqu'il s'agit d'obligations (titres amortissables). C'est ainsi que le krach obligataire de 2022 n'a pas eu d'impact au titre de cette année sur la rentabilité des fonds en euro, dans la mesure où l'assureur n'a pas été dans l'obligation de céder ses positions.
Le fonds euro au plan juridique
Au plan juridique, l'assurance-vie repose également sur une construction originale et exorbitante du droit commun. Par une fiction juridique, le souscripteur du contrat est réputé ne pas détenir les actifs qui forment l'épargne en compte, il est le créancier de l'assureur à hauteur de la contre-valeur desdits actifs.
C'est la raison pour laquelle les capitaux décès sont versés au bénéficiaire sans que ceux-ci ne soient rapportables juridiquement à la succession de l'assuré et supportent une taxation dérogatoire à celle applicable aux mutations à titre gratuit.
En ce sens, l'assurance-vie est un système fiduciaire dont les fondements sont nichés dans un concept-même de notre droit civil, celui de la stipulation pour autrui.
Parlons Patrimoine Septembre 2024
Découvrez les autres articles :
- « Un train peut en cacher un autre »
- 5 % vs 60 % : moyenne de la part de capitalisation dans le système de retraite français vs l'Australie, le Canada et les États-Unis.
- Qu'est-ce que le démembrement de propriété ?
- Retraite : quels sont les trois régimes en vigueur ?
- Le labyrinthe des accréditations du Conseiller en Gestion de Patrimoine
- La réindustrialisation comme thématique d'investissement

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
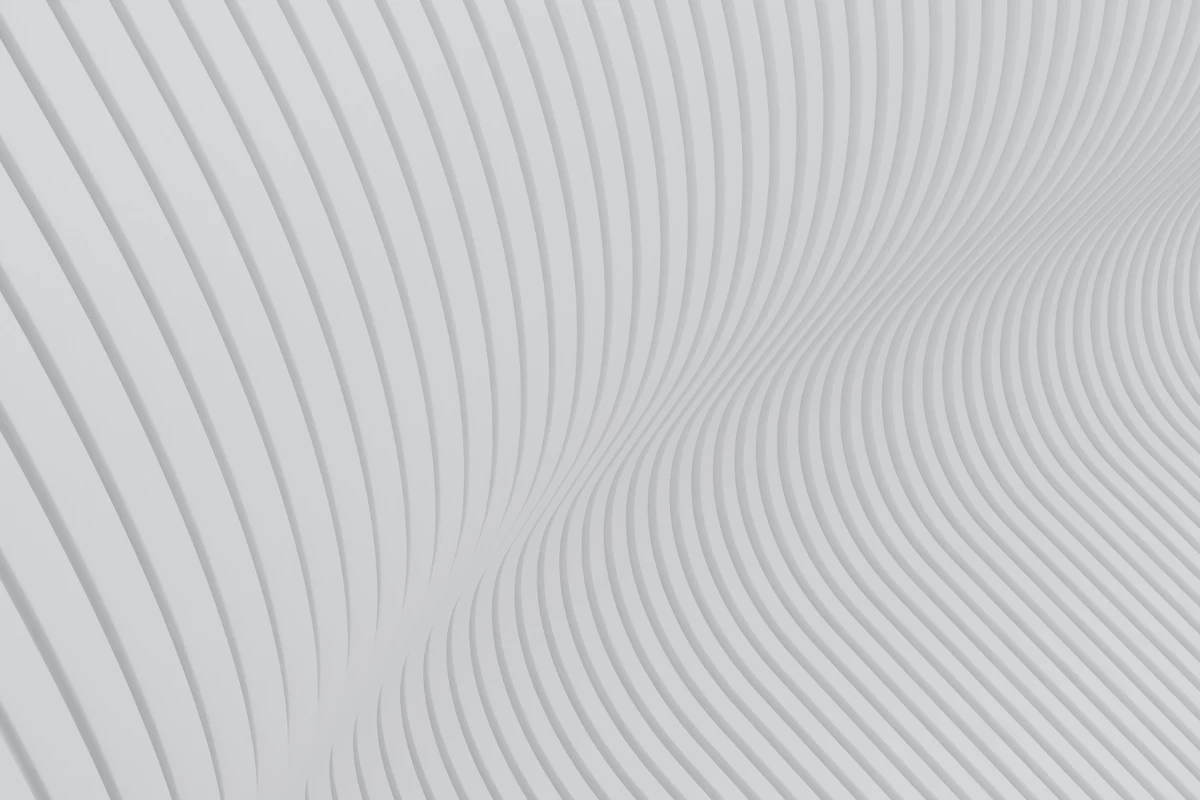
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
