Loi de Finances et rétroactivité : qu'en est-il exactement ?
À l’instar de chaque année, la loi de finances votée en fin d’année, dite loi de finances initiale (LFI), impacte la taxation des revenus de l’année.
La loi de finances rectificative (LFR) ou collectif budgétaire est la seule loi susceptible de modifier en cours d'année, de manière significative, les dispositions de la loi de finances initiale (LFI), concernant notamment les autres impôts que ceux frappant les revenus.
Aussi, la loi fiscale agit de façon rétroactive lorsqu'elle atteint des faits générateurs de l'impôt qui lui sont antérieurs. Et deux hypothèses sont dès lors envisageables :
- Une situation dite de « petite rétroactivité »
- Des formes de pure rétroactivité
Qu'est-ce que la « petite rétroactivité » de la Loi de Finances ?
La nouvelle loi s’applique aux revenus de l’année en cours, soit ceux dont le fait générateur survient au plus tard au 31 décembre pour les particuliers (IR) et à la date de clôture de l’exercice pour les entreprises (IS).
Si elle n'est pas juridiquement rétroactive, la loi de finances entrant en vigueur chaque année avant le 31 décembre, les règles d'imposition (assiette, taux…) des revenus acquis sont alors inconnues. Il s’agit d’une situation subie chaque année.
Naturellement, des opérations ponctuelles n'auraient pas lieu si le particulier avait connu à l'avance la nouvelle loi majorant le montant de l’impôt qu’il doit s’acquitter. En ce sens, un encadrement protecteur serait souhaitable tant il est contre-nature de connaitre les nouvelles règles du jeu une fois les dés lancés. Tel a pourtant été le cas lors de l’instauration de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus par la loi de finance du 28 décembre 2011 pour 2012 et applicable aux revenus de 2011 perçus entre le 1er janvier et la fin de l’année.
Loi de Finances : qu'est-ce qu'une situation de « pure rétroactivité » ?
Par opposition à la situation de « petite rétroactivité » qui affecte les revenus de l’année en cours, il existe des formes de pure rétroactivité :
- Soit spécifiée par la loi et qui forme consensus pour être plus favorable ou pour sanctionner une situation d’abus ou d’évasion fiscale organisée, ou encore pour corriger un texte mal rédigé ou imparfait.
- Soit pour être dans la nature de la loi dite interprétative et qui fait corps avec la loi interprétée.
Aucun principe de non-rétroactivité de la Loi de Finances en France
Contrairement à une opinion commune, il n’existe en France aucun principe général de non-rétroactivité. L’article 2 du Code civil stipule que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » n’a de valeur que législative et la Déclaration des droits de l'homme ne rend inconstitutionnelle que la rétroactivité d’une loi pénale plus dure, incluant, selon le Conseil constitutionnel, ce qui est un moindre mal, la sanction fiscale.
Pour le Conseil d'État et la Cour de cassation, l'interprétation de la loi rétroactive ne peut qu’être restrictive et l’articulation entre la doctrine antérieure et la loi rétroactive doit systématiquement être favorable au contribuable.
Il existe donc des protections à toute forme arbitraire de rétroactivité dont le principe opposé n’a, lui, non plus, aucun caractère absolu.
Parlons Patrimoine Juillet 2024
Découvrez les autres articles :
- La résilience du marché de l’immobilier de luxe
- Investissements alternatifs : des opportunités diverses aux caractéristiques communes
- Enveloppe d'investissement et sous-jacents, quelle différence ?
- Investissement plaisir : des biens divers pour cet été
- "On peut réduire une œuvre d’art à son seul prix, mais cela ne représentera jamais sa valeur réelle." Isabelle Jarry - Artiste, écrivaine, romancière (1959)
- 31% : soit la surface couverte par la forêt en métropole
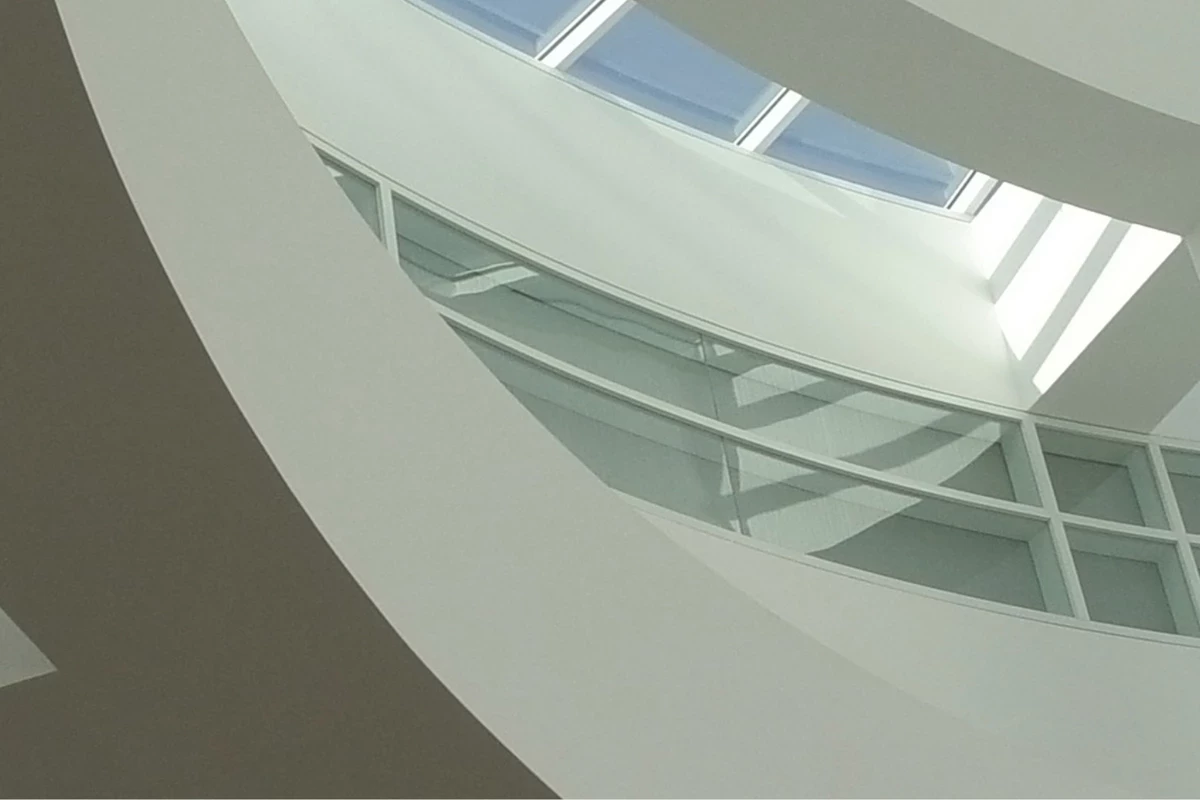
L’administration confirme, dans la réponse ministérielle publiée au JO du 10 février 2026, que peu importe la forme sociale, dès lors que la société exerce une profession libérale, les rémunérations techniques des associés et gérants relèvent des BNC.

Après une absence de consensus du Parlement en fin d’année dernière sur le projet de loi de finances, puis l’adoption d’une loi spéciale en urgence pour permettre à l’État de continuer à percevoir les impôts, la France s’est enfin dotée d’une loi de finances pour 2026.

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).
