Réduction d’impôt ou déduction fiscale, quelles différences ?
Pour diminuer la fiscalité, deux solutions sont à la disposition des contribuables français : la réduction d’impôt et la déduction fiscale.
Mais quelles sont les différences entre ces deux solutions ?
La réduction d’impôt
La réduction d’impôt, comme son nom l’indique, vient diminuer directement l’impôt dû, dans la limite de 10 000 €.
Les solutions les plus fréquemment utilisées sont :
- La réalisation d’investissements
Comme la souscription au capital d’entreprises en direct ou via des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) ou des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI), l’acquisition de biens immobiliers régis par des dispositifs spécifiques type Pinel, Denormandie, des opérations en outre-mer, dans les domaines forestiers…
- L’emploi de salariés à domicile
Entretien du logement, aide aux devoirs, aide aux personnes âgées…
- La déduction des frais de garde pour jeunes enfants (y compris les frais de garde en crèche)
- La réalisation de versement de dons à des organismes d’intérêt général
À noter que ceux-ci ne sont pas comptabilisés pour le plafond des 10 000 € de réduction d’impôt.
La déduction fiscale
La déduction fiscale vient diminuer la base imposable. En réduisant celle-ci, le gain d’impôt est ainsi proportionnel à la tranche marginale d’imposition (de 11 % à 45 % selon les contribuables).
Cette solution est particulièrement adaptée pour les personnes situées dans les tranches d’imposition élevées.
Parmi les mécanismes éligibles, les plus répandus sont :
- Les versements sur des placements d’épargne retraite (type PER, Madelin...)
- Les déficits fonciers, par la déduction des dépenses de travaux sur un bien immobilier locatif qui dépassent le montant des revenus perçus
- Les versements de pension à un enfant majeur ou à un ascendant.
À noter, que ces dispositifs de déduction fiscale, exclus du plafonnement des niches fiscales, ont chacun leur propre plafond de déduction.
Pour optimiser l’impôt à régler, il est souvent pertinent de combiner plusieurs dispositifs de réduction d’impôts et de déduction fiscale. L’accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine s’avère opportun, pour combiner objectifs patrimoniaux et optimisation de la fiscalité.
Parlons Patrimoine Avril 2024
Découvrez les autres articles :
- Et si vous investissiez dans une résidence de tourisme ?
- Il n'est pas trop tard !
- Comment optimiser la stratégie de la rémunération dans le cadre d'une SARL ?
- Le chiffre du mois : 26 %
- Expatriation et imposition : mode d'emploi
- Période fiscale, dernière ligne droite
- Webinar 20′ Patrimoine : Période fiscale : dernière ligne droite pour déclarer !
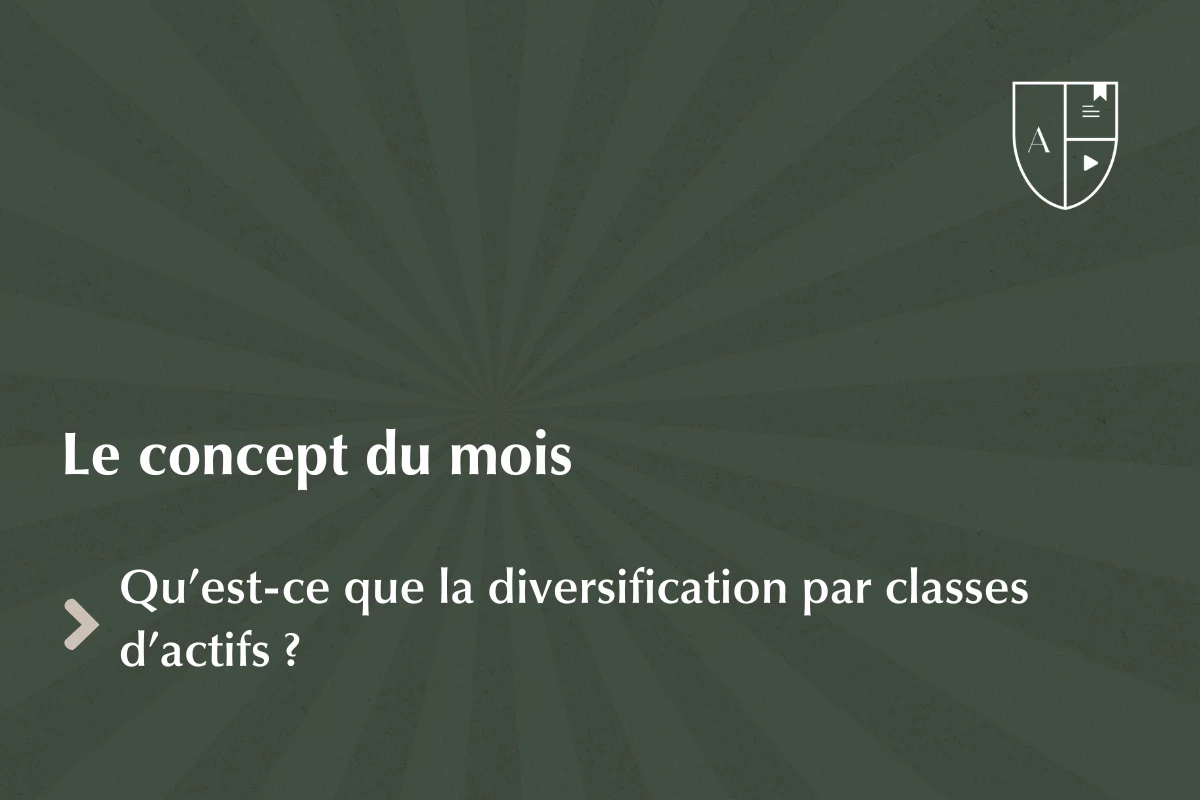
Dans un contexte de marchés incertains, la diversification est un principe essentiel pour réduire les risques, renforcer la résilience de son patrimoine, capter plusieurs sources de performance et protéger ses revenus. La diversification consiste à répartir ses investissements selon différents types d’actifs, zones géographiques, secteurs d’activité ou encore selon des critères extra-financiers.
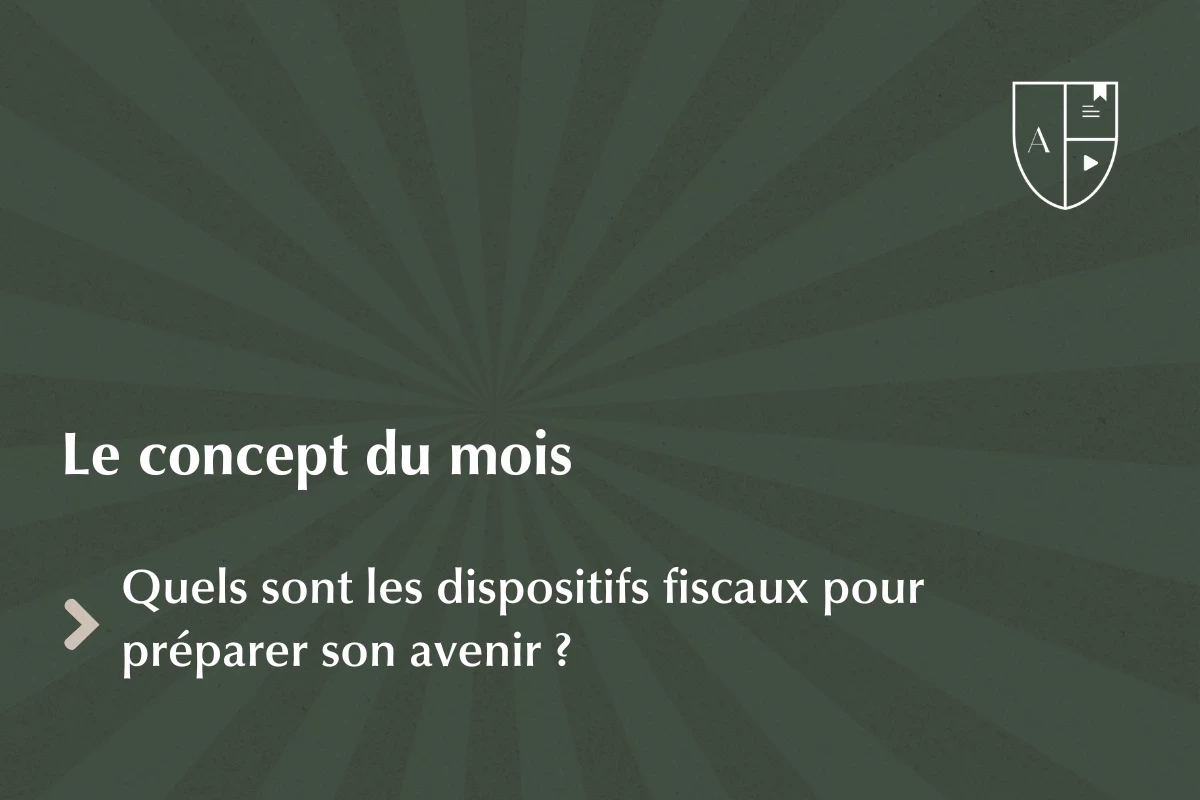
De nombreux dispositifs permettent aujourd’hui de se constituer un patrimoine ou de préparer sa retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Encadrés par des textes législatifs, ces dispositifs peuvent offrir des déductions, réductions ou exonérations d’impôt selon leur nature.
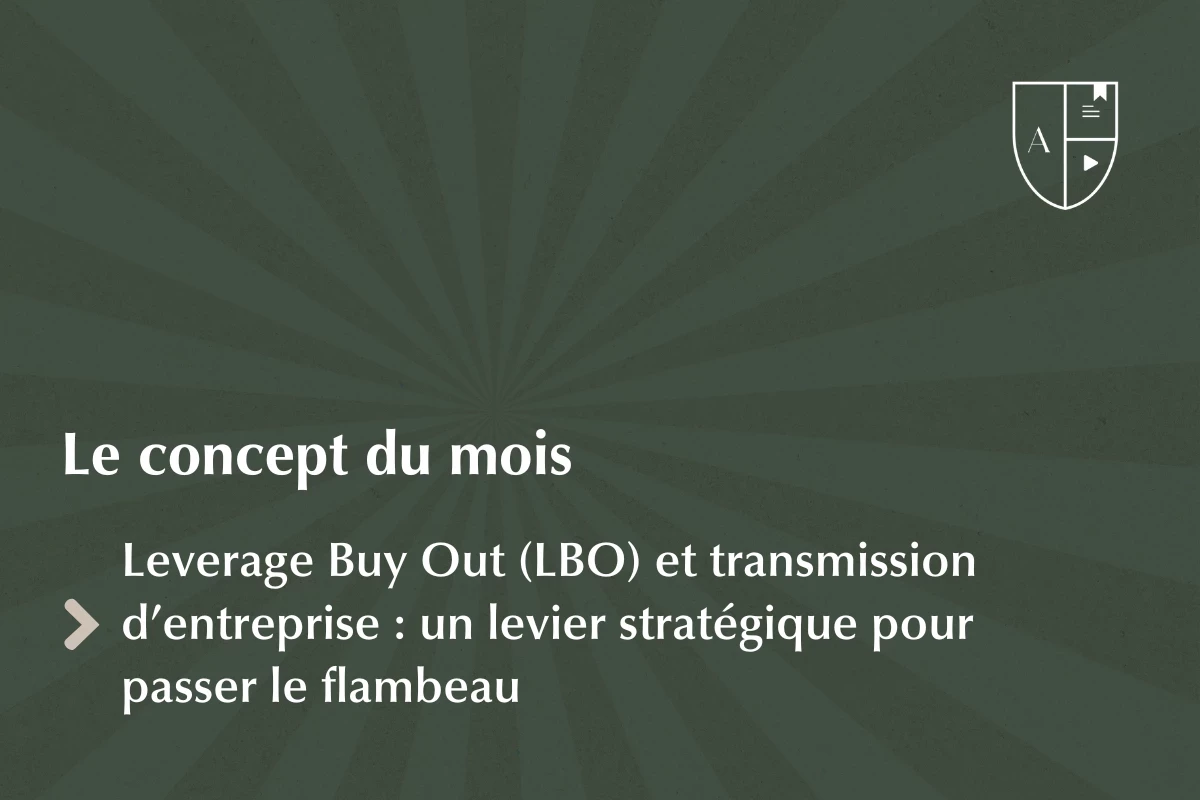
Transmettre son entreprise est souvent l’une des étapes les plus délicates de la vie d’un dirigeant. Après des années d’engagement et de développement, vient le moment de céder ou de partager le capital, tout en assurant la pérennité du projet. Parmi les outils financiers qui facilitent cette transition, le Leverage Buy Out (LBO) et ses variantes, LMBO et OBO, occupent une place majeure.
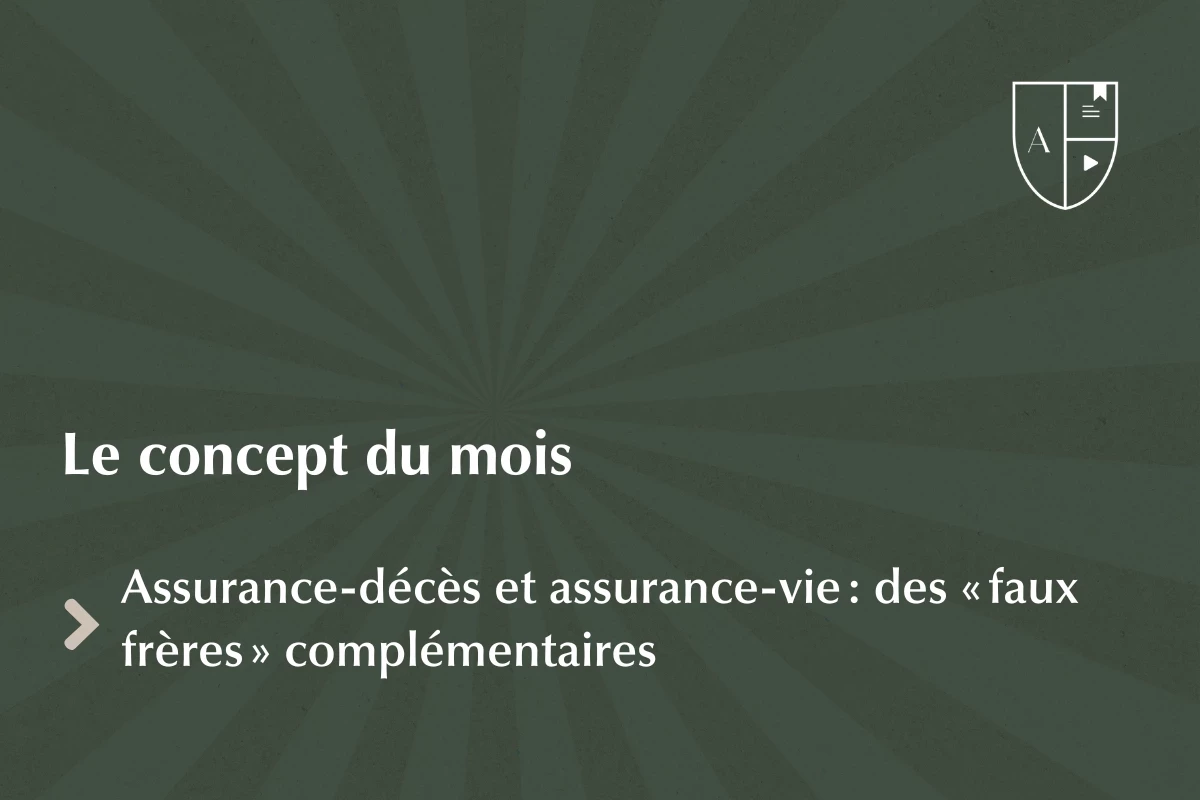
L’assurance-décès et l’assurance-vie sont tous deux des outils phares de la gestion patrimoniale des Français. Leur dénomination pourrait suffire à les différencier, pourtant il n’est pas rare qu’on les confonde à cause de certaines caractéristiques techniques qui demeurent communes aux deux dispositifs.
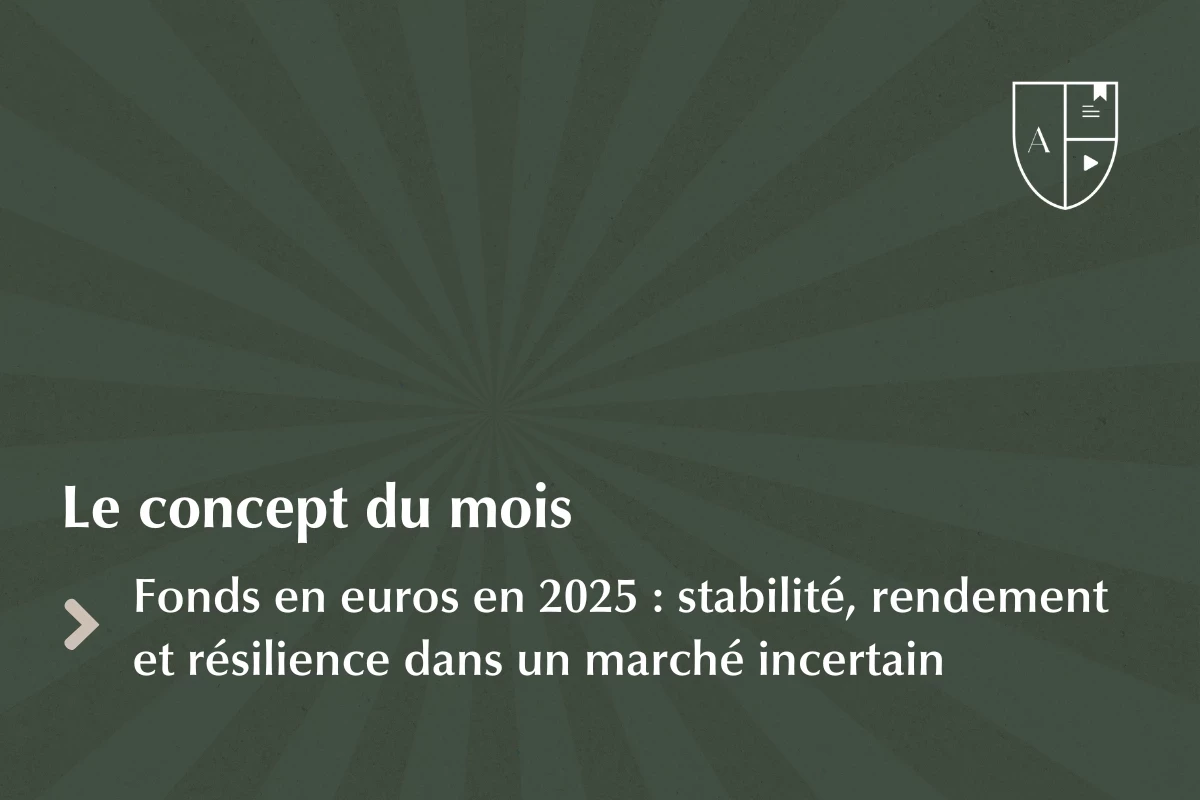
Si en 2025, la collecte sur les unités de compte semble plus dynamique (+10 % sur un an, 38 % de la collecte) que celle des fonds en euros (stable sur l'année), les fonds garantis en euros restent néanmoins le support privilégié des contrats d'assurance-vie.
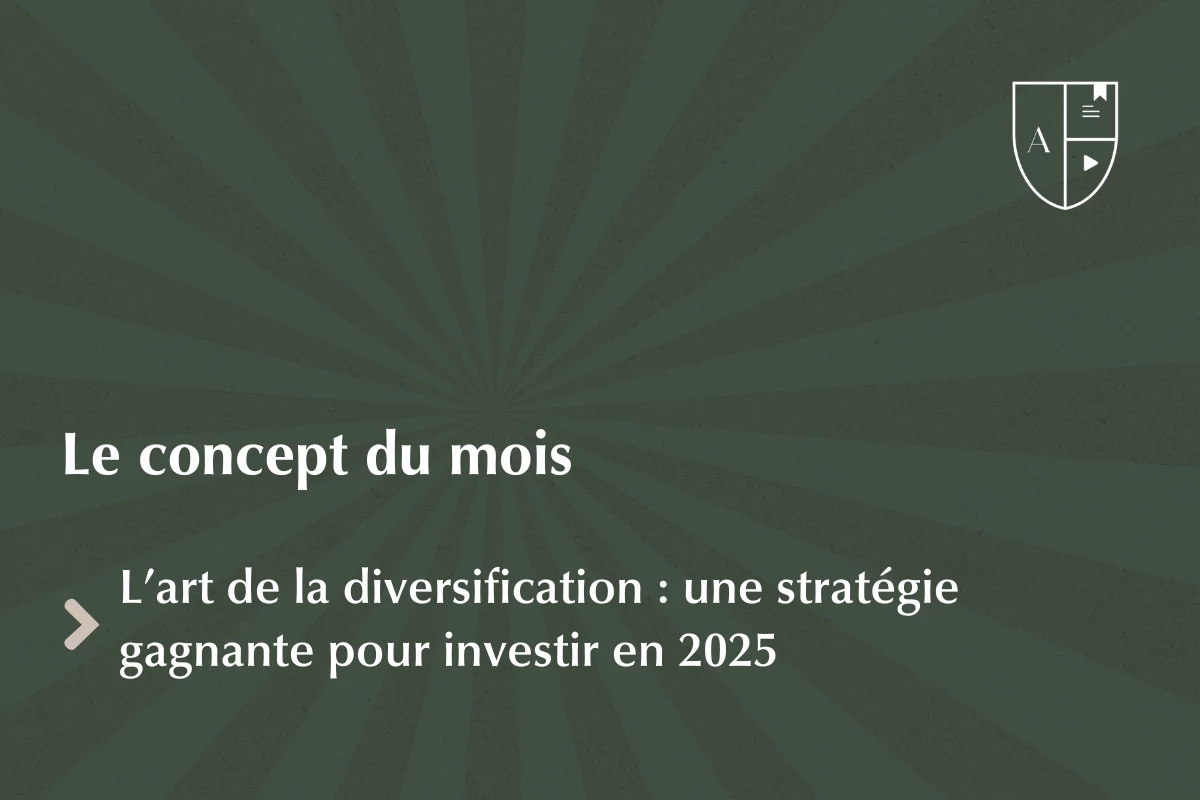
Dans un monde financier en constante évolution, où les incertitudes économiques et géopolitiques peuvent bouleverser les marchés du jour au lendemain, une vérité demeure incontestable : la diversification reste le pilier fondamental d'une stratégie d'investissement réussie. Comprendre et appliquer efficacement ce principe peut faire toute la différence entre un patrimoine qui résiste aux tempêtes financières et un portefeuille vulnérable aux aléas des marchés.
