La RSE, au cœur des préoccupations des entreprises françaises
Les enjeux RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) sont au cœur des préoccupations des entreprises françaises, il deviendra bientôt impossible de les ignorer ! C’est une excellente nouvelle pour les salariés et les organisations.
En effet, au centre des enjeux RSE, la politique salariale et en particulier le partage des profits tiennent un rôle déterminant dans la relation entre employeurs et salariés.
Les dispositifs d’épargne salariale
Les dispositifs d’épargne salariale ne sont pas des nouveaux nés. La mise en place des premiers dispositifs de participation aux bénéfices des entreprises remonte à l’après-guerre, tandis que les premiers plans d’épargne entreprise ont investi la politique salariale française au début des années 60.
Au fil des décennies, ces dispositifs se sont modernisés et adaptés aux contraintes économiques et sociales, jusqu’à équiper près d’un salarié sur deux en France au début des années 2020. Les grands groupes restants encore largement moteurs pour booster ce taux d’équipement.
En tout état de cause, les mesures annoncées par la loi Partage de la valeur de novembre 2023 auront un effet bénéfique sur la diffusion des dispositifs d’épargne salariale, en généralisant leur mise en place au sein des entreprises de 11 à 50 salariés.
Les incitations fiscales et sociales
Les incitations fiscales et sociales sont évidemment au cœur de la réussite des dispositifs d’intéressement, de participation et d’abondement ces dernières années, permettant :
- d’une part aux entreprises de payer un forfait social réduit, voire nul selon la taille de l’entreprise (0 % pour l’intéressement si – 250 salariés, 0 % pour la participation si moins de 50 salariés)
- et aux salariés de bénéficier d’avantages fiscaux sous réserve d’investissement dans des plans d’épargne salariale.
Le message est clair, permettre aux employeurs des plus de 4 millions de PME françaises de rendre accessibles à moindre coût les versements dans les PEE (Plan d’Épargne Entreprise) et les PERCO (Plan d’Épargne Retraite Collectif) au travers des solutions d’épargne salariale.
Car si l’entreprise y voit comme vertus la fidélisation de ses salariés (sujet hautement stratégique au vu des tensions sur le marché de l’emploi) et un engagement dans des pratiques salariales responsables, en intégrant par exemple des critères RSE dans le déclenchement des primes d’intéressement, les salariés ne sont pas laissés pour compte.
Pour les salariés, les conditions fiscales sont inédites et constituent un moteur puissant de performance grâce aux exonérations fiscales sur les plus-values (hors prélèvements sociaux à 17,2 %) au bout de 5 ans de détention des fonds sur le PEE ou au moment du départ à la retraite sur le PERCO.
L’épargne « accompagnée »
La constitution d’une épargne « accompagnée » par l’entreprise, au travers du partage des bénéfices ou de l’atteinte d’objectifs mutuellement profitables à l’entreprise et aux salariés, est un enjeu majeur des années à venir.
En effet, c’est un moyen d’aider ces mêmes salariés à développer leur épargne en vue de projets à moyen terme ou en prévision de leur future retraite.
Ce dernier point devient d’ailleurs de plus en plus crucial au regard des déséquilibres de notre système de retraite par répartition, qui ne peut à lui seul prétendre maintenir les acquis sociaux en matière de retraite et assurer le financement de la dépendance. Un modèle mixte répartition et capitalisation se dessine donc peu à peu, et les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner le mouvement.
Rappelons enfin que les chefs d’entreprise sont pour la plupart éligibles aux dispositifs d’épargne salariale, ce qui pour une TPE-PME doit être intégré dans la politique de rémunération globale du chef d’entreprise et peut constituer un levier d’économies non négligeable pour la société.
Les récentes réformes législatives n’ont eu de cesse de renforcer l’attractivité des mécanismes de l’épargne salariale, en apportant des simplifications et en rendant plus flexible la mise en place des dispositifs pour les PME. Les plans d’épargne eux-mêmes évoluent pour répondre aux besoins des salariés, en offrant des possibilités d’investissements plus diversifiées, avec une orientation ISR (Investissement Socialement Responsable) ou RSE. Les plans d’épargne eux-mêmes évoluent pour répondre aux besoins des salariés, en offrant des possibilités d’investissements plus diversifiées, avec une orientation ISR (Investissement Socialement Responsable) ou RSE.
Parlons Patrimoine Février 2024
Découvrez les autres articles :
- Optimisation des flux en Private Equity
- La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie
- Le chiffre du mois : 8,3 milliards d'euros
- Comment rendre son épargne utile ?
- Quelles sont les différentes typologies des Organismes de Placement Collectif ?
- Le cycle de vie du capital investissement
- Histoire d'entrepreneurs : Pascal Barcella
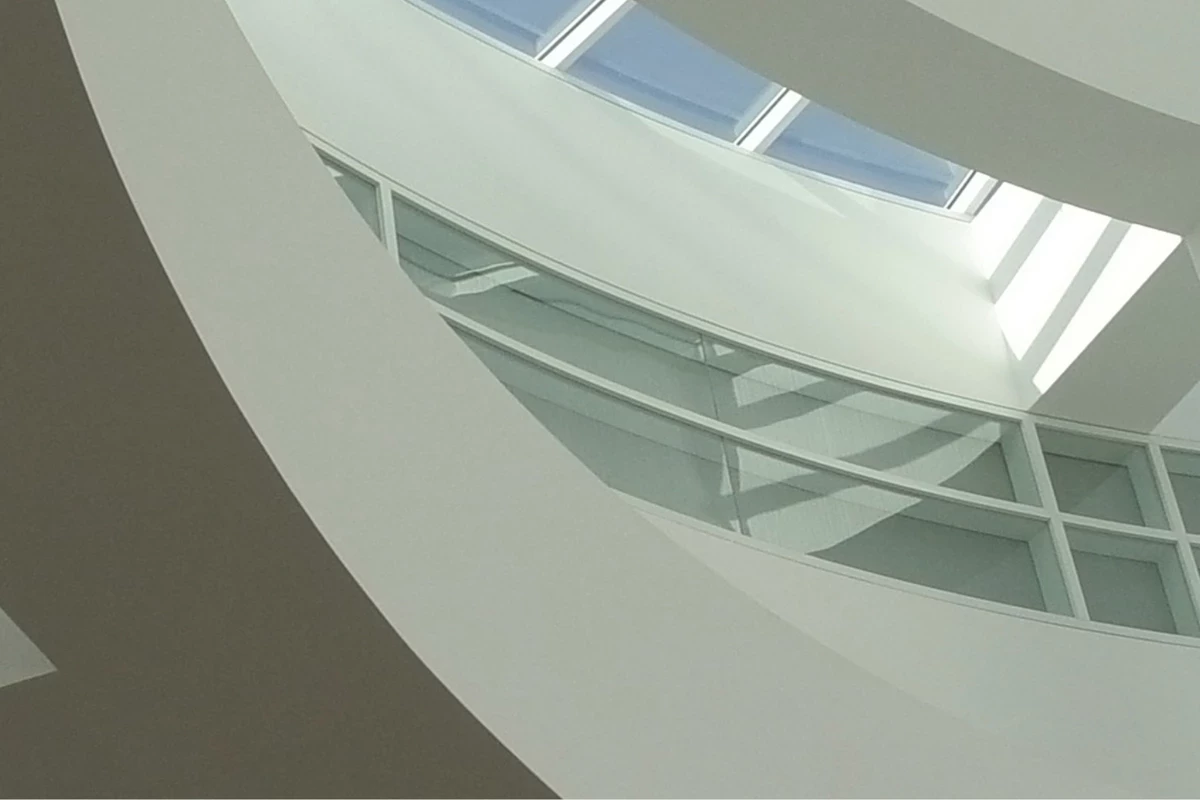
L’administration confirme, dans la réponse ministérielle publiée au JO du 10 février 2026, que peu importe la forme sociale, dès lors que la société exerce une profession libérale, les rémunérations techniques des associés et gérants relèvent des BNC.

Après une absence de consensus du Parlement en fin d’année dernière sur le projet de loi de finances, puis l’adoption d’une loi spéciale en urgence pour permettre à l’État de continuer à percevoir les impôts, la France s’est enfin dotée d’une loi de finances pour 2026.

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).
