Quels avantages à optimiser la transmission de son patrimoine avec les donations transgénérationnelles ?
Devant l’allongement de l’espérance de vie, il n’est pas rare d’envisager l’anticipation de la transmission de son patrimoine sur plusieurs générations. Depuis 2006, la donation transgénérationnelle répond à cette problématique en permettant, au donateur de réaliser un « saut de génération » en gratifiant directement ses petits-enfants, et ce, au détriment de ses enfants qui acceptent de « céder leur place » à la génération suivante. Ce dispositif n’est donc ouvert que sous réserve de l’existence d’une descendance.
La donation transgénérationnelle peut porter sur des biens présents donnés par l'ascendant en pleine propriété ou en utilisant la technique du démembrement. Par exemple, le recours à cette méthode permet au donateur de transmettre la nue-propriété d'un bien à ses petits-enfants et l'usufruit à son enfant. Il est également envisageable de prévoir des usufruits successifs, « réversibles » profitant successivement à plusieurs bénéficiaires qui leur assurent la jouissance successive des biens (par exemple, au profit du conjoint ou partenaire survivant puis d'un enfant).
Réincorporation d’une donation antérieure
En outre, le législateur offre la possibilité au donateur de procéder à la réincorporation d’une donation antérieure dans une donation-partage transgénérationnelle, et ce, en prévoyant la réattribution des biens donnés aux descendants du donataire initial.
Ce « saut de génération » permet de réaliser la transmission dans des conditions fiscales particulièrement avantageuses. En effet, et sous réserve que la donation initiale à réincorporer ait été effectuée depuis plus de 15 ans, cette donation ne sera soumise qu’au seul droit de partage au taux de 2,5 % (non-éligibilité au taux de 1,1 %). Dans l’hypothèse d’une donation initiale réalisée depuis moins de 15 ans, l’opération serait soumise aux droits de donation selon l’âge de l’usufruitier à la date de la nouvelle transmission, sous déduction des droits initialement acquittés.
Prenons pour exemple
Un père, Albert, qui donne à son fils Philippe, la nue-propriété d’une maison en Bourgogne, en se réservant l’usufruit. Vingt ans plus tard, Philippe commence à travailler sa propre succession et envisage de transmettre à son tour la nue-propriété reçue à sa fille Victoire, et ce, en maintenant l’usufruit à son profit lorsque Albert viendra à décéder.
Pour ce faire, la solution proposée en premier lieu consisterait à ce que Philippe donne la nue-propriété à Victoire dans le cadre d’une nouvelle donation. Après avoir été donataire, Philippe endosse le rôle du donateur. D’un point de vue fiscal, les droits seront liquidés sur la valeur de la nue-propriété donnée évaluée compte tenu de l’âge de l’usufruitier. En supposant qu’Albert a 75 ans, et que le bien vaut désormais 500 K€ en pleine propriété, les droits s’élèveraient à environ 48 K€ après application de l’abattement de 100 K€. Il est bon de noter que Philippe pourra, à l’occasion de cette donation, se réserver l’usufruit du bien au décès d’Albert. En cas de prédécès de ce dernier, Victoire pourra demander une restitution d’impôt égale à ce qu’elle aurait acquitté si la base imposable avait été déterminée selon l’âge de Philippe lors de la donation dont elle a bénéficié. Au cas particulier, en considérant que Philippe a 53 ans, cela représenterait une restitution de 20 K€ environ.
Une seconde solution consisterait à utiliser la technique de la donation transgénérationnelle en réincorporant la donation antérieure réalisée au profit de Philippe. Dans cette hypothèse, la nue-propriété est directement transmise par Albert à Valentine moyennant le paiement d’un seul droit de partage de 2,5 % sur la valeur du bien donné (donation initiale réalisée depuis plus de 15 ans). Au cas particulier, le droit de partage s’élève à 8 K€. Dans cette hypothèse également, il semble envisageable de prévoir un usufruit successif sur la tête de Philippe en cas de prédécès d’Albert. Une restitution du surplus de droit de partage pourra alors être demandée par Valentine, à hauteur de 2K €.
La technique de la réincorporation d’une donation dans une donation-partage transgénérationnelle permet donc de réduire de manière significative les droits de mutation (dans notre exemple, ces droits ont été divisés par 6).
Lorsqu’elle est adaptée au contexte de la famille et à la volonté des ascendants de transmettre le patrimoine aux générations futures, et ce, en accord avec les enfants, cette technique doit donc être privilégiée.
Enfin, précisons que les économies fiscales ainsi réalisées ne nous semblent pas de nature à être remises en cause par l’Administration fiscale dans le cadre des dispositifs d’abus de droit ou du mini-abus de droit. En effet, cet outil juridique et le régime fiscal associé sont, en tout point de vue, conformes à l’intention du législateur, à savoir, faciliter les sauts de génération dans l’organisation d’une transmission de patrimoine et ce en tenant compte de l’allongement de l’espérance de vie des premières générations.
Parlons Patrimoine Décembre 2023
Découvrez les autres articles :
- Donner avant de s'expatrier ou s'expatrier avant de donner ?
- Transmission du patrimoine : comment choisir entre le don de somme d'argent ou le présent d'usage ?
- Comment anticiper la transmission de son patrimoine ?
- Comment transmettre des biens immobiliers ?
- Transmission subie ou organisée : quelles différences ?
- Quelles solutions pour optimiser l’abattement sur les donations ?

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
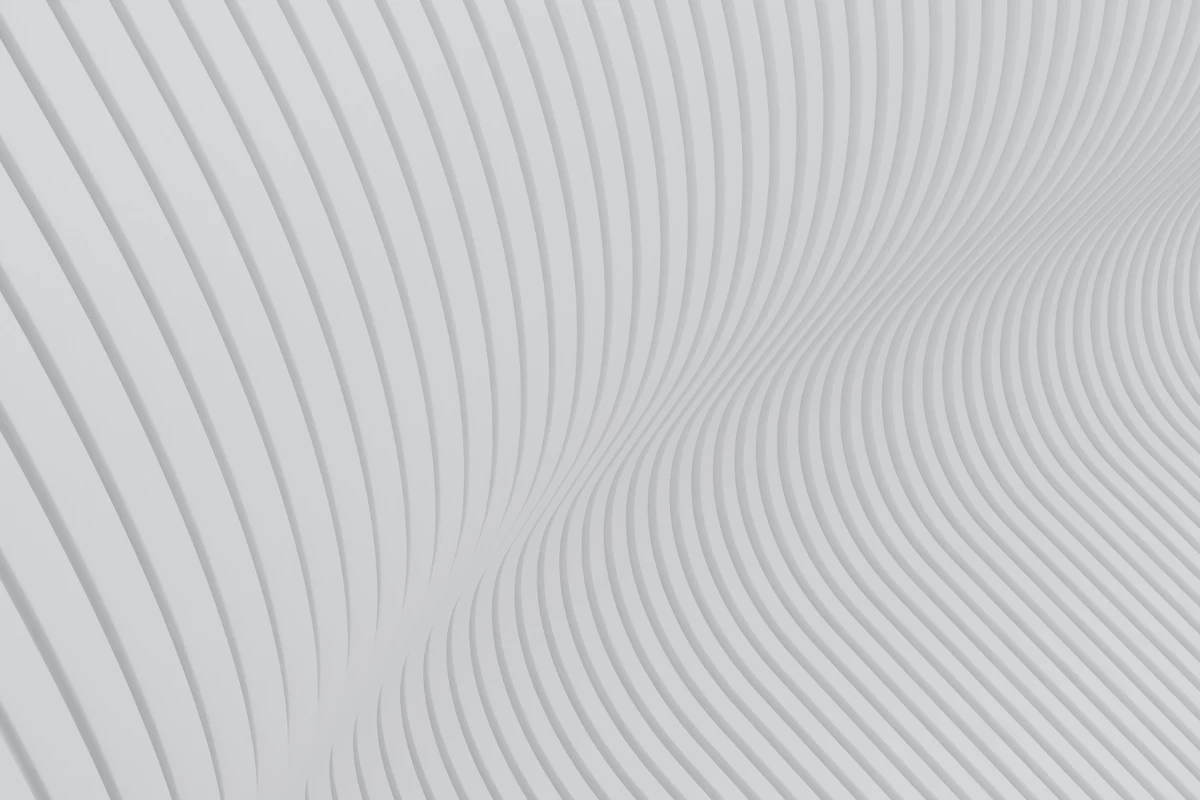
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?

La location meublée non professionnelle (LMNP) est un régime fiscal attractif pour les particuliers souhaitant investir dans l’immobilier meublé. Elle permet notamment de bénéficier d’avantages fiscaux importants, en particulier grâce au mécanisme d’amortissement du bien. Toutefois, des évolutions législatives récentes ont modifié ce cadre, réduisant certains bénéfices lors de la revente du logement. Il est donc essentiel de bien comprendre les règles du régime LMNP avant de s’engager.

L’ensemble des collaborateurs de Laplace vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2026

La fulgurante ascension des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle suscite des comparaisons inquiétantes avec la bulle internet de 2000. Le Nasdaq affiche une progression spectaculaire, portée par les géants de la tech dont les valorisations atteignent des sommets. Pourtant, malgré certaines similitudes, la situation actuelle présente des différences fondamentales qui invitent à la nuance plutôt qu'à la panique.

Pour de nombreux dirigeants et professions libérales, la question n’est plus seulement "comment se constituer une retraite complémentaire", mais comment le faire tout en optimisant la fiscalité de son revenu professionnel.
