Rôle, consentement et trajectoire de l’impôt
Le rôle de l’impôt a évolué au fil des siècles pour progressivement modifier ses objectifs économiques, ce qui perturbe le consentement à l’impôt.
Un rôle original et originel
Dans sa conception classique, l'impôt sert à la couverture des dépenses publiques de la communauté ou de la société, les dépenses des services publics. Ce rôle original, et originel, de l'impôt est d’autant plus facilement acceptable que l’Etat utilise le prélèvement pécuniaire pour l’affecter, en vertu de sa puissance exclusive et régalienne, à des dépenses protectrices et éducatives.
L’article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, reprend cette conception classique de l’impôt dans son énoncé et a force de loi Suprême en ce qu’elle a « pleine valeur constitutionnelle »[1] : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Un rôle contributif et redistributif
Progressivement, la fonction de l’impôt en tant que levier au service d’une politique économique a permis à l’Etat de taxer les domaines ne devant pas faire l'objet d'un effort et de détaxer ceux devant faire objet d'une promotion. L’impôt permet alors d’orienter les comportements des agents économiques - particuliers ou entreprises – vers les directions souhaitées par les acteurs politiques et sociaux décisionnaires.
Les rôles de l’impôt peuvent donc se définir par leurs caractères contributifs et redistributif. Au 20ᵉ siècle, ce dernier a fini par… s’imposer. La notion d’équité fiscale prime sur les conceptions traditionnelles qui fondent les principes de l’imposition. Elle est obtenue par la progressivité de l’impôt, que l’on retrouve en matière d’impôt sur les revenus d’activités ou de droits de mutation à titre gratuit, contrairement à la proportionnalité de l’imposition, qui a la faveur du législateur en matière de taxation des revenus du capital[2].
La loi fiscale mute en un instrument par excellence de la politique de l'État en matière économique, ce à des fins de justice sociale.
Une des raisons qui menèrent les barons à se révolter contre le roi Jean sans Terre, le 15 juin 1215, fut son usage excessif et arbitraire des droits féodaux, dont la levée de nouvelles taxes. La réitération de la Charter of Liberties, la Magna Carta[3], limita ce pouvoir royal dans sa douzième clause qui consacre le principe du consentement à l'impôt[4].
L’avènement des démocraties parlementaires repose pour partie sur le consentement à l'impôt.
Un double consentement
En 2022 et 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires[5] a identifié les ressorts du consentement à l’impôt des contribuables français. Le constat est éclairant : les classes moyennes sont celles qui se vivent comme les plus écrasées fiscalement, tandis que, collectivement, le niveau des prélèvements obligatoires est sous-estimé par une majorité des répondants.
Le Professeur Michel Bouvier[6] distingue le consentement à l’impôt et le consentement de l’impôt :
- « Le consentement à l’impôt » est l’acceptation de principe de l’impôt. Il s’agit donc de l’acceptation sociologique de l’impôt par le contribuable lui-même en tant que citoyen. Le respect des obligations déclaratives par les assujettis en découle, car le contribuable n’est pas en rupture avec son civisme fiscal.
- « Le consentement de l’impôt » suppose que la levée du prélèvement soit explicitement acceptée par ceux sur qui en retombe la charge ou par leurs représentants. Il est donc avant tout de portée politique : le citoyen approuve le consentement de l’impôt exprimé par ses représentants.
À l’inverse du consentement de l’impôt, non sondée, le consentement à l’impôt est mesuré. Et 75% des Français pensent que le niveau d’imposition en France est trop élevé[7].
Si une majorité de Français continue à porter un jugement négatif sur le niveau et l’équité des prélèvements fiscaux et sociaux, le paiement des impôts et cotisations demeure pourtant considéré comme un acte citoyen.
La problématique du niveau des prélèvements obligatoires en France interfère naturellement sur le consentement à l’impôt : en 2022, 45,2 % de notre richesse nationale sont prélevés en impôts, taxes et cotisations, ce qui nous place en tête du classement européen[8].
Une réforme fiscale s’impose-t-elle ?
Alors la question de la réforme fiscale idéale pour l’avenir, si complexe soit-elle, se pose nécessairement, et ce, afin de restaurer le consentement à l’impôt. La baisse des prélèvements obligatoires et une juste redistribution des taxes naitraient de l’exploration de quatre pistes à travailler :
- La simplification du système fiscal pour rendre les règles plus claires et plus faciles à comprendre, en éliminant, par exemple, nombre des 465 niches fiscales de notre législation,
- La justice fiscale qui pourrait impliquer de revoir la répartition de l’impôt entre les différents groupes de revenus, notamment ceux des entreprises, et de prendre des mesures pour lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, terrains de jeux de trop de firmes internationales.
- La digitalisation de l’économie suppose de rebattre le cadre fiscal national et international actuel pour s’adapter à la réalité sans frontières des entreprises numériques.
- Face à l’urgence climatique, taxer les réels pollueurs et inciter fiscalement les énergies décarbonées.
Ces pistes peuvent constituer des amorces de réflexions afin de réconcilier le contribuable, l’impôt et son usage dans une trajectoire de maîtrise de nos dépenses publiques.
[1] Conseil constitutionnel : Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982
[2] Depuis le 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » s’applique ainsi aux revenus du capital de particuliers.
[3] La Grande Charte ou Charte des Libertés
[4] No scutage or aid may be levied in our kingdom without its general consent[...]
[5] https://www.ccomptes.fr/fr/publications/barometre-des-prelevements-obligatoires-en-france-premiere-edition-2021 et https://www.ccomptes.fr/fr/publications/barometre-des-prelevements-fiscaux-et-sociaux-en-france-deuxieme-edition-2023
[6] https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/268486-le-consentement-de-limpot-les-mutations-du-citoyen-contribuable
[7] https://www.ccomptes.fr/fr/publications/barometre-des-prelevements-fiscaux-et-sociaux-en-france-deuxieme-edition-2023
[8] https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/2022-lannee-record-des-prelevements-obligatoires-depuis-trente-ans
Parlons Patrimoine Janvier 2024
Découvrez les autres articles :
- Le chiffre du mois : 3,4 %
- Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
- Immobilier : où investir en 2024 ?
- Placements financiers : quelles perspectives pour 2024 ?
- Vivre son expatriation au Moyen-Orient
- Hausse des taux d'intérêt : quels impacts sur la dette publique ?
- Loi de finances, quelles nouveautés pour 2024 ?
- Regards croisés - Portrait d'Alexandre Menini, un ancien sportif professionnel engagé
- Webinar 20' Patrimoine : "Comment investir en Private Equity ?"

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
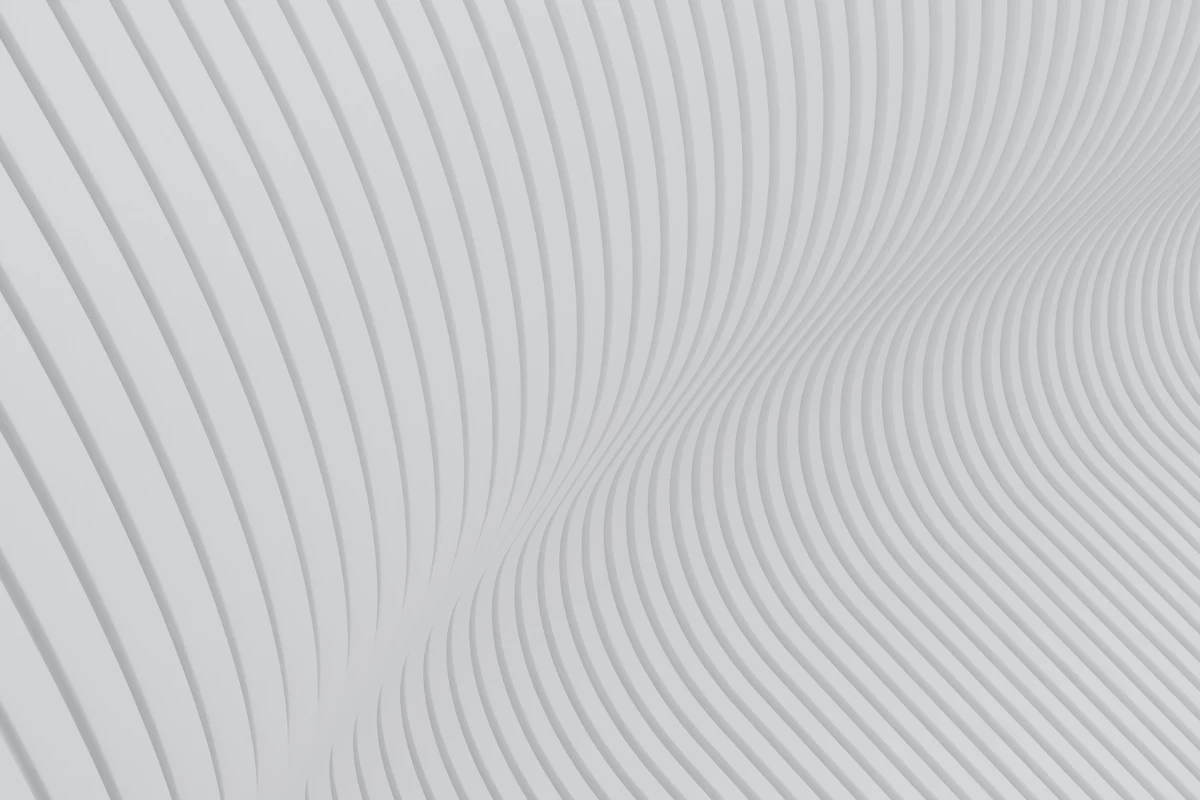
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
