Comment minorer l’imposition de la cession de titres ?
À l’occasion de la vente d’un titre de société, le particulier est taxé sur la plus-value réalisée, définie comme la différence entre son prix d’acquisition et celui de sa cession.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, lorsque la société émettrice est une entité soumise à l’impôt sur les sociétés, la plus-value est soumise de plein droit à la « Flat Tax » ou « Prélèvement Forfaitaire Unique » (PFU), qui s’élève à 12,8 % d’impôt sur le revenu et à 17,2 % de prélèvements sociaux, soit une imposition totale de 30 %.
À ce taux global de 30 %, depuis 2011, une Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), et non temporaire, a été instituée. Son taux, 3 ou 4 %, dépend du revenu fiscal de référence du cédant et de sa situation familiale.
Dès lors, et au-delà de 1 M d’euros de gain taxable, la plus-value est en toute hypothèse taxée à 34 %.
À défaut de pouvoir minorer ce taux, il s’agit de réduire l’assiette sur laquelle il porte.
La donation préalable et l’apport cession
L’intérêt d’une donation ou d’un apport des titres à une entité soumise à l’impôt sur les sociétés est de purger entièrement la plus-value latente afin de ne pas la supporter au moment de leur cession. Lorsqu’un apport ou une donation précède la cession, la différence de valeur entre l’acquisition des titres par le cédant et celle de l’apport ou de la donation sera seulement constatée dans le bilan de la société ou dans l’acte de donation.
Le cédant donateur ou apporteur ne dégagera aucun gain réel de cette opération, il se dépossédera ou bénéficiera de titres en contrepartie de son apport.
Au moment de la cession, la plus-value sera calculée en référence à une valeur figée au jour de la donation ou de l’apport, laquelle recèle des gains latents…non taxables. Dans l’hypothèse où le délai entre l’apport ou la donation et la cession par les cessionnaires est bref, le gain constaté sera par hypothèse nul.
De ce fait, la plus-value initiale accroîtra le prix d’acquisition pour le cédant, donataire ou société bénéficiaire de l’apport.
Ces deux mécanismes permettent donc de juguler l’imposition.
Cette optimisation tient principalement à la chronologie des opérations. La donation ou l’apport doivent nécessairement être réalisés préalablement à la cession des titres.
La brièveté du délai entre la donation ou l’apport et la cession est sans incidence sur le caractère fictif de l’opération[1].
Pour redresser l’opération sur le terrain de l’abus de droit, l’Administration fiscale ne saurait se suffire de l’existence d’un projet de cession avant la donation ou l’apport. Seul importe le transfert de propriété.
1. L’opération de donation avant cession
Lorsqu’un donateur souhaite transmettre le prix de la cession d’un titre, il risque d’être soumis à la fois à l’imposition de la plus-value, lors de la vente, et aux droits de mutation à titre gratuit, lors de la donation du produit de la vente.
Afin de réduire cette imposition, l’opération peut être inversée. Il s’agira, en premier lieu, de réaliser la donation du bien au donataire, qui ira à la cession. Certes, la transmission sera assujettie aux droits de mutation à titre gratuit, mais après application des abattements et en bénéficiant, en ligne directe, des tranches basses du barème progressif.
L’arrêt de principe « Motte-Sauvaige » rendu par le Conseil d’État le 30 décembre 2011[2], admet qu’une donation préalable à une cession ne constitue pas un abus de droit au sens de l’article L64 du Livre des Procédures Fiscales, sauf à ce que cette donation soit fictive, c’est-à-dire à défaut de dépouillement irrévocable et immédiat du donateur[3].
Il peut, par exemple, être fait défaut à cette condition dans l’hypothèse où le donataire est un enfant mineur. Dans ce cas, les fonds de la cession ne doivent, en aucun cas, passer par les comptes courants du parent donateur, afin d’éviter toute confusion de fonds avec le patrimoine de l’administrateur légal[4].
Pour éviter tout redressement pour fictivité, les formalités de droit commun doivent être réalisées. La donation entre vifs doit faire l’objet d’un acte devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats[5].
Sur ce point, le Conseil d’État a estimé que n’était pas fictive la donation-partage accompagnée d’une clause licite au regard des règles du Code civil, telles qu’une clause de remploi, d’inaliénabilité ou de blocage de fonds[6].
L’intention libérale du contribuable est indispensable, elle peut notamment être justifiée par sa volonté d’organiser sa transmission et de pérenniser les rapports familiaux.
2. L’opération d’apport avant cession
Là encore, afin d’écarter toute fictivité, les conditions de droit commun doivent être réalisées au moment d’un apport de titre, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, en vue de la cession de titres apportés.
Le transfert de propriété résulte de la rémunération de l’apport par l’octroi de titre à l’apporteur, opération devant respecter le formalisme propre à toute création de capital social.
Cependant, ce mécanisme de report d’imposition est encadré par les dispositions de l’article 150 0b Ter du Code Général des Impôts.
Cet article a initialement été rédigé en vue de favoriser les restructurations et le développement d’entreprise en conférant un caractère intercalaire aux opérations d’échange de titres. Il concerne les apports réalisés à compter du 14 novembre 2012[7].
Pour cela, il prévoit un report d’imposition de la plus-value générée par l’apport des titres.
Ce report est subordonné au respect de deux conditions :
- D’une part, l’apport doit être réalisé en France, ou au sein de l’Union Européenne, ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
- D’autre part, la société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par l’apporteur, à la date de l’apport, soit en droit (par la détention de la majorité des droits de vote directement ou indirectement pour une part supérieure ou égale à 33,33 %) ou en fait (orientation et détermination de la gestion).
Conformément à l’article 150-0b Ter du CGI, le report d’imposition prend fin dans différentes hypothèses reprises dans le schéma suivant :
S’il peut apparaître singulier que la plus-value d’apport soit placée en report d’imposition sur la tête du donataire, ce principe a néanmoins été jugé conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans une réponse de QPC publiée le 12 avril 2019[8].
De ce fait, le donataire devra mentionner, dans la proportion des titres reçus, le montant de la plus-value en report dans sa déclaration de revenus.
Quoi qu’il en soit, aucune opération de donation ou d’apport de titres préalablement à leur cession ne saurait être envisagée sans qu’elle ne s’inscrive dans le cadre d’une stratégie patrimoniale intégrant les données familiales et les objectifs propres à chacune des parties prenantes.
[1] Conseil d’Etat, 10 février 2017, n°387.960
[2] Conseil d’Etat, 30 décembre 2011, n°330.940
[3] Article 894 du Code civil
[4] Conseil d’Etat, 5 février 2018, n°409.718[5] Article 931 du Code civil
[6] Conseil d’Etat, 9 avril 2014, n° 353.822
[7] Loi de finances pour 2012, article 18
[8] Conseil Constitutionnel, réponse QPC, 12 avril 2019, n°2019-775

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
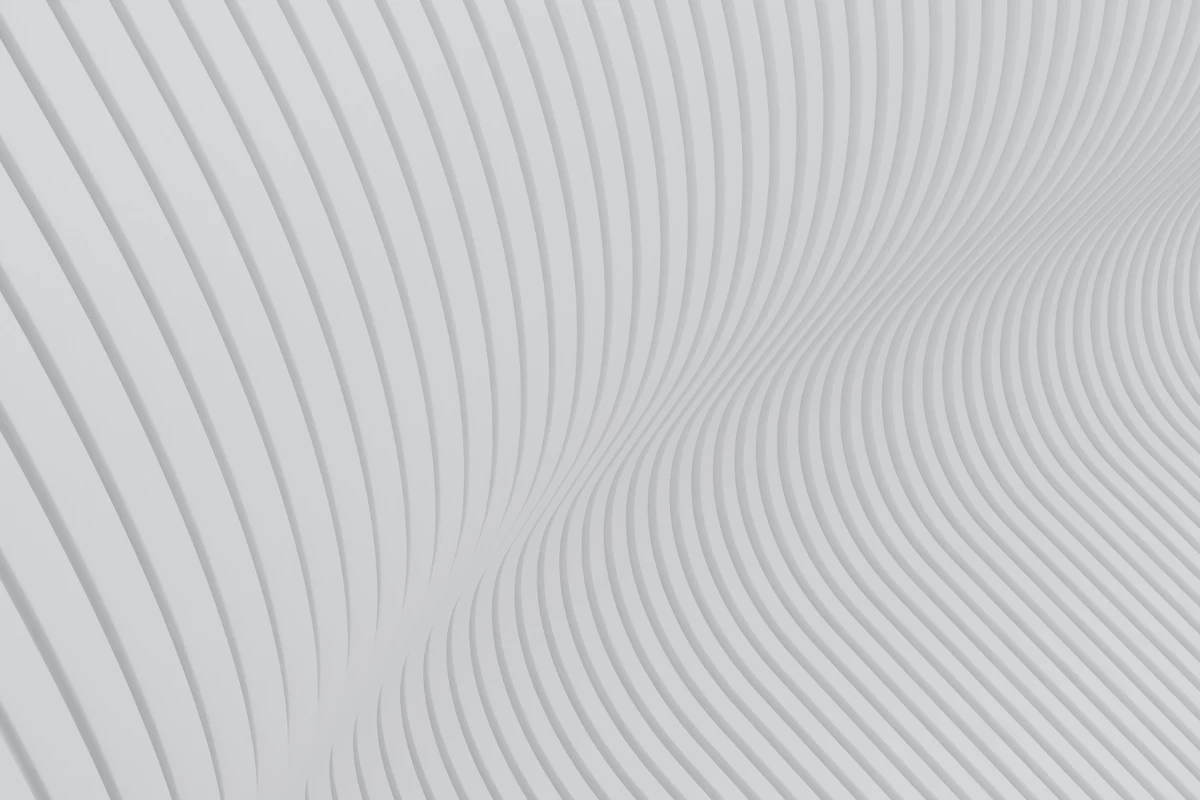
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
