La libéralité résiduelle au soutien des transmissions intergénérationnelles
Les donations consenties par les grands-parents à leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement spécifique dont la limite, 31 865 € par gratifié, se reconstitue, tous les 15 ans. Pour la part excédant l’abattement, le barème applicable est celui existant entre ascendant et descendant, soit le même que celui en vigueur entre parent et enfant, dont le taux est progressif (de 5 % à 40 %).
Cependant, il ne s’agit pas, sous un prétexte d’optimisation fiscale à tout crin, d’omettre les incidences civiles d’une telle libéralité.
Les implications juridiques et successorales de la transmission transgénérationnelle
D’une part, le saut de génération ne doit pas s’avérer préjudiciable aux enfants du disposant, héritiers auxquels doit impérativement revenir une part du patrimoine : la réserve héréditaire. Celle-ci se calculant au jour du décès du disposant, il est nécessaire de veiller à ne pas amputer le patrimoine d’une manière trop importante, soit par le biais de libéralités, soit par la diminution au fil du temps de ses avoirs, rendant ainsi les biens existants au jour du décès si faibles que la réserve serait entamée et la libéralité réduite.
D’autre part, une des incidences peu décrite de la donation aux petits-enfants repose sur un ordre chronologique imprévu d’ouverture de succession.
Prenons l’exemple suivant : un grand-père veuf a une unique fille, divorcée, mère d’un seul enfant. Le grand-père donateur serait alors surpris d’apprendre que les biens transmis à son petit enfant pourraient accroître le patrimoine de son ex-gendre suite à des décès successifs incohérents : le décès de son petit-enfant survenant postérieurement au sien, mais avant celui de sa fille1. La qualité successorale de l’ex-gendre lui permettrait de recueillir, en effet, la moitié des biens donnés au défunt petit-enfant.
Les donations résiduelle et graduelle : une stratégie pour sécuriser la transmission transgénérationnelle
Fort de la connaissance de cette dévolution, le grand-père recherchera une parade. Elle repose sur la donation résiduelle sinon graduelle qui permet d’organiser la transmission de biens au-delà d’une seule génération en bénéficiant d’un régime fiscal favorable.
Il s’agit là d’une disposition par laquelle le grand-père consent une donation de biens identifiables à une première personne (son petit-enfant) en précisant :
- Que ce qu’il en laissera à sa mort reviendra à une ou plusieurs personnes nommément désignées par le disposant (sa propre fille ou toute autre personne de son choix2) : il s’agit alors d’une donation résiduelle.
- Ou bien qu’il devra conserver l’actif qui reviendra au jour de sa mort à une personne désignée par le disposant : il s’agit dans cette hypothèse d’une donation graduelle.
Au jour de la donation, le bien appartenant au petit-enfant sera transmis à la tierce personne désignée dans l’acte3. Cette personne désignée sera, par une fiction légale, réputée tenir ce bien directement du donateur.
En présence d’une donation résiduelle, le premier institué n’est pas nécessairement tenu de conserver les biens transmis : il peut en disposer entre vifs, à titre onéreux comme à titre gratuit (ce dernier cas peut cependant lui être expressément interdit par le disposant). Le droit de l’institué en second est donc aléatoire : il pourra seulement prétendre au résidu, c’est-à-dire à ce qu’il restera des biens transmis.
Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une donation graduelle : le premier bénéficiaire doit obligatoirement conserver le bien jusqu'à son décès. La donation graduelle permet de s'assurer que le bien reste dans la famille sur plusieurs générations, ce qui peut éviter des ventes forcées et préserver ainsi le patrimoine familial.
Tout comme l’assurance-vie qui repose, elle aussi, sur une opération tripartite, cette typologie de donations régit les relations entre trois sujets de droit de telle manière que l’on peut avancer l’idée que ce mécanisme singulier constitue un exemple de fiducie dissimulée dans notre droit civil.
Initialement de construction prétorienne, la loi du 23 juin 2006 4 a entériné ce type de donations. Le principal attrait de cette codification est de définir ces libéralités en alignant expressément le régime des donations sur celui des legs, abondamment visés par la jurisprudence.
Fiscalité des donations résiduelle et graduelle : un avantage successoral optimisé
Au plan fiscal, le régime de ces donations suit celui des transmissions sous conditions suspensives.
Le premier gratifié est redevable des droits de mutation à titre gratuit selon son lien de parenté avec le disposant en bénéficiant, notamment, des abattements.
Le second institué ne sera redevable de droits que dans la mesure où il recevra tout ou partie des biens au jour du décès du premier gratifié et d’après son degré de parenté avec le disposant dont il tient directement ses droits. Mieux : les droits éventuels réglés par le premier institué seront imputés sur ceux dus sur les mêmes biens par le second. ll en résulte une seule taxation pour une double transmission.
La transmission d’un patrimoine se prépare sur la durée et à tout âge. Depuis plus de 30 ans, nos équipes vous accompagnent dans l’anticipation et l’optimisation de votre succession.
Découvrir un cas pratique dédié à la donation résiduelle et graduelle

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
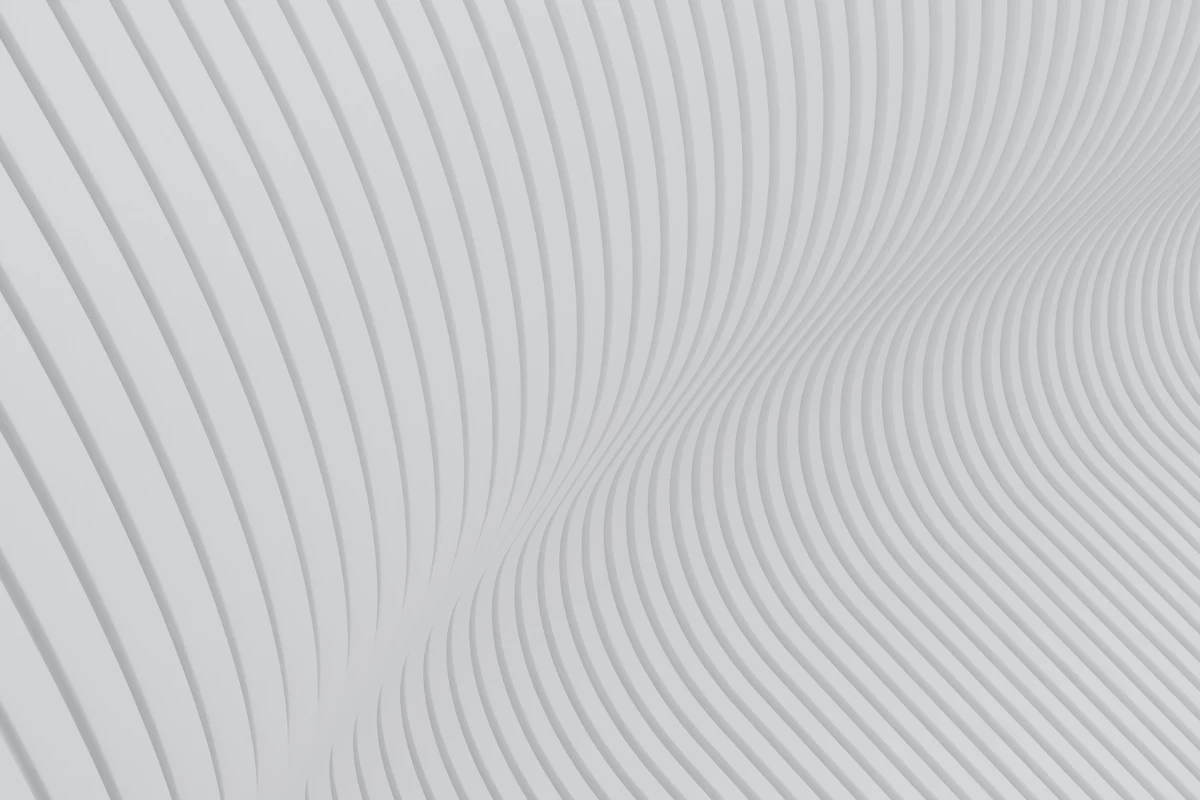
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
