Désintermédiation bancaire et hausse des taux, frein ou opportunité pour les intermédiaires de financement ?
La dégradation des conditions de financement bancaire n’a échappé à personne. Les modèles de financements alternatifs se sont développés pour s’y substituer et répondre aux besoins des jeunes entreprises innovantes, mais également pour des projets rentables dans des secteurs très variés. La hausse des taux se pose-t-elle alors comme un frein ou une opportunité pour les intermédiaires de financement non bancaires ?
Vulnérabilité du système bancaire et décroissance de l’octroi de crédit
Après des années de taux bas, le resserrement rapide de la politique monétaire a eu pour objectif de contenir l’inflation. Les taux d’intérêt ont été relevés drastiquement et rapidement, ce qui a accru les risques pesant sur les intermédiaires financiers, et notamment les banques. Les tensions financières passées qui ont suivi des périodes d’inflation élevée et de hausses rapides des taux d’intérêt illustrent bien ce phénomène.
Même si les banques disposent aujourd’hui de fonds propres renforcés pour surmonter ces épreuves et que le risque de crédit a fortement diminué depuis 2008, les faillites soudaines de Silicon Valley Bank et de la Signature Bank ont rappelé la vulnérabilité du système bancaire. Tout comme la perte de confiance à l’égard de Crédit Suisse. Et lorsque la perte de confiance est généralisée, les financements peuvent vite disparaître…
De plus, les coûts de financement pour les banques ont mécaniquement augmenté et la capacité à octroyer du crédit a diminué. Alors que nous attendons un assouplissement monétaire, l’inflation reste élevée, risquant de faire perdurer la situation.
Avec l’essor des institutions financières non bancaires, le financement alternatif devient accessible aux particuliers
Banques d’investissement, sociétés de crédit-bail, compagnies d’assurance, fonds d’investissement, sociétés de financement… Il existe une multitude de structures non bancaires pour accompagner les entreprises et soutenir la croissance.
En effet, lorsque les banques ne peuvent financer un projet, de la croissance ou encore soutenir un bilan durant une difficulté passagère, certaines structures non bancaires offrent quant à elles des services aux entreprises, comme la souscription d’emprunt. Mais ces sociétés ne disposant pas d’agrément bancaire et ne pouvant pas recevoir les dépôts des épargnants (et donc n'étant pas en capacité de créer de la monnaie scripturale), ce sont les liquidités des financeurs/investisseurs qui financeront directement les besoins d’entreprises.
Arrêtons-nous sur deux modèles de financement :
- Le crowdfunding
Modèle le plus connu du grand public, il permet d’intermédier un projet d’entreprise et une multitude d’investisseurs prêts à investir un montant souvent faible. Le risque est élevé et beaucoup de plateformes évoluent dorénavant vers du financement de projets immobiliers.
- Les fonds
Les liquidités collectées sont mutualisées au sein d’une structure dont l’objectif sera de financer plusieurs besoins d’entreprises. Ils peuvent obtenir d’investisseurs institutionnels des sommes très importantes et soutenir ainsi le développement des entreprises de manière conséquente.
Certains fonds sont spécialisés – financement de projets dans les énergies renouvelables, santé, immobilier – d’autres seront spécialisés pour répondre aux besoins patrimoniaux de la clientèle privée.
Il existe donc aujourd’hui un grand nombre de moyens de financement. Les financements coûtant aujourd’hui plus cher facialement, les promesses de rendements proposés aux investisseurs suivent également cette hausse.
Toutefois, il convient d’appréhender les propositions au regard de l’inflation et du risque émetteur dans un contexte où le taux d’endettement global rend vulnérable le système financier mondial.
Le FMI (Fonds Monétaire International) a d’ailleurs cette année souhaité la mise en place d’une surveillance et d’une réglementation accrue de ces intermédiaires afin de limiter l’intervention des banques centrales dont le but est de résoudre des besoins de liquidité et non de solvabilité.
Pour conclure, même si pléthore de projets proposent aujourd’hui des rendements très attractifs sur le papier, une analyse approfondie et l’accompagnement par un professionnel demeurent nécessaires !

L'année 2026 s'annonce sous le signe d'une croissance économique modeste mais généralisée, portée par des politiques monétaires et budgétaires accommodantes sans précédent en temps de paix. Dans ce contexte favorable mais non dénué de risques, nous privilégions une approche équilibrée combinant exposition aux marchés actions, diversification géographique et sectorielle, ainsi qu'un positionnement stratégique sur les obligations européennes.

Le marché immobilier résidentiel en 2025, a démontré son pouvoir de résistance dans un contexte pourtant complexe. Les prévisions de 2026, indiquent une poursuite de l’activité.

Malgré des années de contraction des levées ayant marqué plusieurs secteurs, notamment celui du LBO (Leveraged Buy-Out), 2025 confirme la montée en puissance des actifs privés au sein des portefeuilles institutionnels, ainsi que ceux de la clientèle privée.

Malgré les multiples défis qui caractérisent cette décennie, la croissance économique mondiale devrait faire preuve de résilience et atteindre 3,1 % en 2026. Aux États-Unis, l'économie devrait afficher une croissance de 2 %, conforme à son rythme tendanciel. Cette performance s'appuie sur la robustesse de la consommation des ménages, notamment ceux à revenus moyens et supérieurs, et sur l'impact croissant des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'année 2025 aura confirmé l'entrée dans une ère de "conflictualité économique" généralisée. Les tensions ne se limitent plus aux seuls échanges commerciaux : elles touchent désormais les domaines technologique, énergétique, militaire et monétaire. L'indice de fragmentation géopolitique mondiale, qui avait déjà bondi après l'invasion de l'Ukraine en 2022, continue sa progression, témoignant d'une modification profonde de l'ordre économique international établi depuis les années 1990.
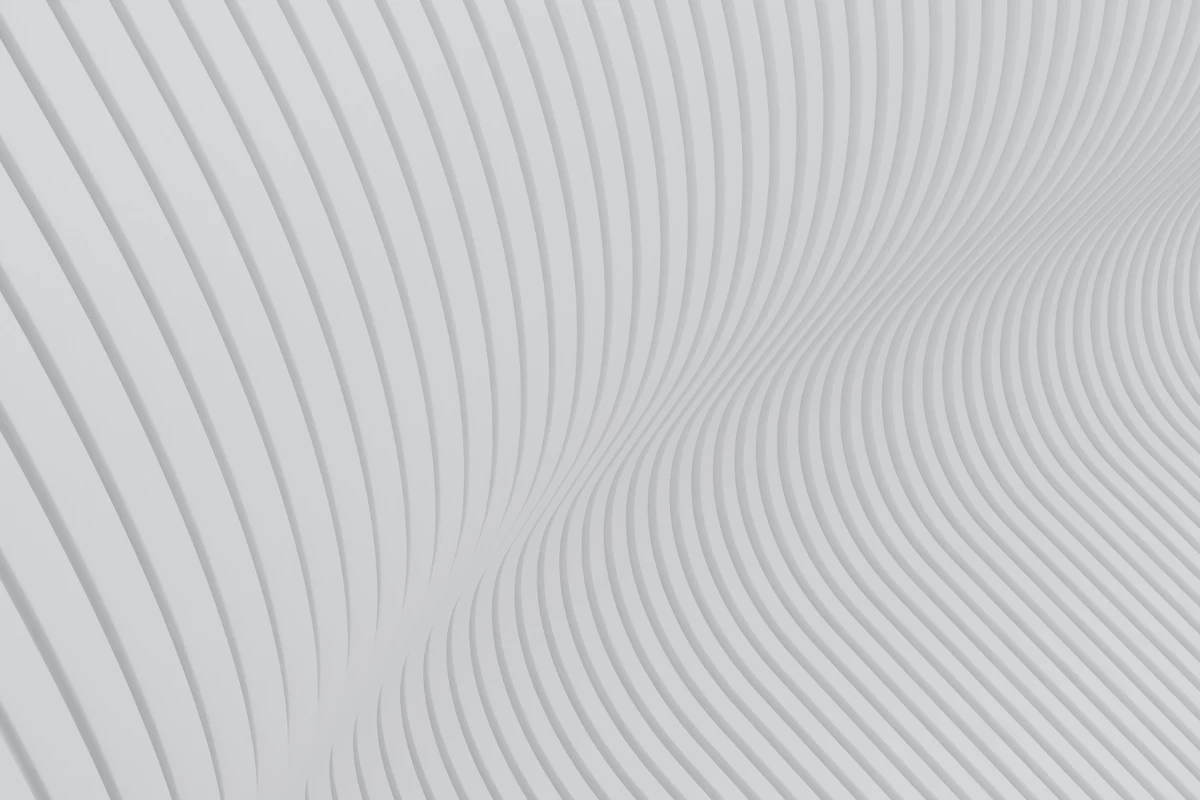
L’impôt sur la fortune dite improductive voté le 31 octobre dernier vise entre autres les fonds garantis des compagnies d’assurance, dits fonds général ou encore fonds en euros. Avec un encours dépassant les 1 300 milliards d’euros (Source ACPR), ils représentent autour de 70 % des montants investis en assurance-vie. Mais sont-ils vraiment improductifs ?
